|
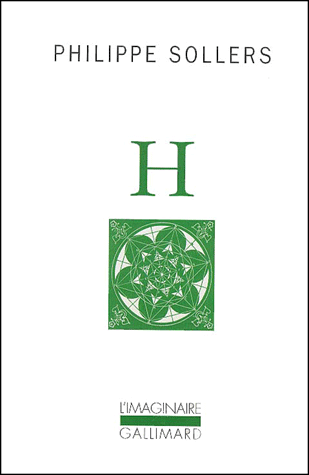
Cela se passe comme une
danse de derviche.
Le Monde du 29 novembre 1974
L'écriture,
c'est pour vous, en somme, la partie apparente de l'iceberg. Et la partie
immergée, en quoi consiste-t-elle ?
Philippe Sollers : D'une façon large, il s'agit d'une connaissance
du corps. Les rapports qu'entretient un écrivain avec ses sens, avec son
odorat, avec son toucher et surtout avec sa sexualité, c'est très important.
Mais, en ce qui me concerne, je préciserai que 90 % de mon travail consiste à
écouter. On a beaucoup trop tendance, en effet, à faire de la littérature une
question de visibilité. C'est cette dominante de la vue sur l'ouïe qui est
responsable de toute la contrainte qu'ont exercée la psychologie et la
représentation naturaliste sur la littérature (moi-même, j'ai été à demi-sourd,
jusqu'à Lois). Que signifie écouter ?
Eh bien ! cela veut dire surtout se mettre dans un
état presque musical de porosité, à la fois volontaire et involontaire,
conscient et inconscient, pour essayer de saisir ce qui se passe d'inconscient
dans la langue.
Efforcez-vous de repérer chez tous
les gens avec qui vous parlez ce qu'ils disent derrière les mots, il est clair
que vous aurez bientôt une certaine expérience de l'oreille. L'accentuation, le
ton, vous indiqueront très vite qu'ils sont en train d'exprimer exactement le
contraire de ce qu'ils pensent. Vous avez là-dessus des passages célèbres de
Proust. Mais je crois qu'il faut aller en fait beaucoup plus loin que la simple
« sous-conversation ». Il faut arriver à une écoute analytique. Vous avez lu le
journal de l'analyse de L'Homme aux rats de Freud (je ne crois pas qu'on puisse faire de la littérature, de nos jours,
sans passer par Freud), on y voit très bien que ce qui est entendu dans un mot
comme « rat » est tout autre chose que ce qui est réellement dit. Voilà ce
qu'est l'écoute pour moi : quelque chose d'interne. Comme dans un rêve où vous
entendez des choses alors qu'aucun son n'est émis. Dans ce curieux processus
d'analyse, ce qui fait voir c'est le fait d'avoir entendu et non l'inverse.
Et l'on peut tout de même
souligner que très peu d'écrivains s'astreignent à cette discipline.
Est-ce
que vous prenez des notes ?
Ph. S. : Cela va de soi. Je
conçois mal qu'un écrivain ne soit pas tout le temps à noter, un peu comme un
analyste qui prendrait tout le monde (et de façon désintéressée) en analyse.
J'ai d'ailleurs toujours un carnet sur lequel j'amasse, au café, dans la rue,
chez moi, chaque fois que cela vient, les différentes briques qui viendront
s'intégrer en cours de rédaction. (Pour les choses sur lesquelles je n'ai pas
encore à travailler, j'utilise un fichier qui constitue une sorte de
micro-encyclopédie à usage personnel : astronomie, critique philosophique,
etc.)
Tantôt, je note un proverbe, un mot
en sanscrit qui m'a frappé; ou bien, c'est un dessin: par exemple le monogramme
du Christ : HCE que j'ai découvert dans une bible enluminée et qui a servi de
matrice à Joyce pour Finnegans Wake (cela m'a paru illuminant pour expliquer le fonctionnement même du signifiant
chez Joyce), ou encore (il s'agit alors d'une prospective de souvenirs destinée
à une tentative d'auto-analyse) c'est un nom de villa où j'ai vécu, enfant, la
photo du château du Prince noir, près duquel j'allais jouer (vous vous souvenez
du poème de Nerval : « Le prince d'Aquitaine à la tour abolie »). L'essentiel,
c'est que tout cela va se mettre à rayonner dans ma mémoire. À partir, ainsi,
d'un mot, d'un dessin, d'une photo, c'est toute une constellation de souvenirs
que je vais pouvoir retrouver.
Mais attention, je ne note jamais
ce qui se passe sous ma fenêtre. Le réalisme, cela m'intéresse uniquement dans
la mesure où la réalité passe à travers le discours.
Quelle sorte de discours ? Eh
bien, je vous dirai que parmi l'énorme matériel dont je me sers pour essayer
d'en faire l'analyse, à la fois historique et inconsciente, et de le réécrire
sous forme rythmique, je travaille plus systématiquement sur trois sortes de «
corpus » : à savoir, le discours religieux (en ce moment je m'attaque à la
Bible), le discours scientifique (les accélérateurs de particules, quels
déclencheurs d'imaginaire ! ) et le discours pornographique (j'ai une assez
importante collection de textes en circulation dans les sex-shops). Pourquoi
ces trois discours ? Eh bien, justement parce qu'ils se veulent exclusifs les
uns les autres, alors qu'ils sont en réalité complices. Ce que j'essaie, c'est
de faire éclater cette étanchéité des discours qui assure le pouvoir.
Et
l'écriture, comment se déroule-t-elle ?
Ph. S. : Alors là, c'est
l'équivalent d'un acte musical, acte que j'accomplis souvent après (pas
pendant, il y a alors trop de vacarme dans ma tête) avoir écouté de la musique
: Haydn, Monteverdi, Schoenberg, Stockhausen... Mon rêve, ce serait d'arriver à
créer une sorte d'opéra de la langue. C'est difficile parce que le français,
colonisé par le classicisme, ne se prête guère à ce genre d'opération. Aussi,
depuis Lois (1972), j'utilise tout au
long de la rédaction un magnétophone afin de retravailler les différents
passages en fonction de leur effet sonore. C'était un peu la technique développée
par Joyce pour Finnegans Wake : si
vous écoutez l'enregistrement qu'il a fait lui-même de cette œuvre en 1934,
vous vous apercevrez que sa voix y passe à tour de rôle du grave à l'aigu et
que ce texte qui a l'air opaque est en fait un système de modulation de voix.
Évidemment, il faut tenir compte
du fait qu'on n'est pas toujours dans le même état pour écrire, et que s'il y a
des moments où cela semble aller de soi, il y en a d'autres, au contraire (je
ne sais pourquoi les écrivains sont si discrets sur ce chapitre) où rien ne
marche. C'est pourquoi, en réalité, j'utilise deux techniques de travail
différentes : la première, manuelle, est destinée aux moments où, mon état
psychique étant insuffisant, il faut procéder de façon un peu chirurgicale ; la
seconde, pour les moments où, sous l'effet de circonstances « heureuses », mon
ordinateur cérébral fonctionne convenablement, fait appel à la machine qui
permet, elle, d'obtenir des rendements extrêmement intéressants. Alors là, cela
se passe comme une danse de derviches. Je fais tourner à la fois les phonèmes
et le sens. Cela donne une espèce de bombardement que, désormais, je transcris
sans signes visibles de ponctuation, parce que justement, à ce moment-là, tout
n'est que ponctuation. J'ajoute qu'à ces deux techniques correspondent des
lieux de travail séparés, et que celui destiné à la machine est équipé d'un
piano. C'est normal : l'écriture à la machine n'est-elle pas, comme le piano,
un acte de percussion ? N'y a-t-il pas, là aussi, un état de clivage des deux
mains par rapport au cerveau qui est radicalement différent de la position
traditionnelle du scribe ?
Mais il va de soi que, dans la
réalité, toutes les différentes opérations qui constituent mon travail sont
plus ou moins simultanées. Et finalement, s'il fallait une comparaison
ironique, je dirais que je ressemble pendant tout le temps que je consacre
(généralement le matin très tôt, entre 20 minutes et 3 heures) à l'écriture, à
une déesse Kâli à mille bras s'agitant en tous sens. Le seul moment où il ne
peut être question que de faire une seule chose c'est celui où l'on doit
décider si, oui ou non, l'on va rendre un certain état définitif. C'est toujours
dramatique. Mais il faut bien en passer par là. Ne serait-ce que pour
s'apercevoir un jour que c'est raté. Car je rate toujours ce que je fais. Mais
quel est l'écrivain qui arrive à dire un peu ce qu'il voulait ? Peut-être est-ce
là d'ailleurs un bon critère pour juger celui qui est dans l'expérience et
celui qui n'est pas.
Savez-vous
à l'avance, au moment de commencer un livre, ce que vous allez dire ?
Ph. S. : Un psychanalyste
demande-t-il à son patient ce qu'il compte lui dire pendant la séance ?
L'écriture, c'est la même chose, on peut toujours se prononcer à l'avance : «Je vais raconter ceci ou cela», rien ne se déroule comme prévu. À une époque
très formaliste comme la nôtre, il faut insister sur ce côté indécidable de
l'expérience. C'est en cela que réside justement son risque d'échec. Vous
connaissez Jean Ricardou ? On a l'impression qu'on peut lui dire : « Passez-moi
une commande : établissement X... » Non, ce n'est pas possible. On s'est fâché.
Dans mes premiers livres, il y
avait, c'est vrai, une certaine structure établie à l'avance. Drame, c'était un dialogue entre « je »
et « il », se déroulant en soixante-quatre cases comme au jeu d'échecs. Nombres, c'était un jeu entre « je », «
il » et « vous » sur une scène carrée avec ses trois côtés et l'espace
ouvert qui la fait communiquer avec la salle. Lorsque j'ai commencé Lois (mon projet étant de réécrire La Grande logique de Hegel), j'avais
construit un cube. Mais, en cours de route, celui-ci a éclaté et tout s'est mis
à se dérouler autrement que prévu. Je me suis, par exemple, aperçu que tout ce
que j'écrivais était en pentasyllabes : sans doute, l'influence inconsciente de
mai 1968. Le côté slogan, le martellement : « na na na - na na ». Alors à
partir de H, j'ai décidé de ne plus
mettre des digues, de laisser passer ce qui devait se passer. J'ai supprimé les
majuscules, pour montrer que rien n'est graphique, que tout est prononçable.
Mais le plus curieux, c'est qu'en
décidant que mon seul critère serait désormais d'être débordé par ce que j'écrivais
j'ai résolu par la même occasion le problème du début. Vous savez que Freud a
dit qu'une première séance d'analyse contient déjà tous les éléments qui
mettront des années à ressortir. Il en va de même pour l'écriture. Alors, si
vous organisez le jeu à l'avance, le problème du début devient presque
insoluble. Autrefois, j'empruntais mes débuts à des rêves (Drame, Nombres): Aujourd'hui, je puis être beaucoup plus ambitieux.
Le début de H, je l'ai ajouté après coup.
D'abord j'avais commencé par le récit, écrit le soir même, de la manifestation
pour l'enterrement de Pierre Overney. Et puis, au moment d'achever le livre,
j'ai été arrêté. Lorsque la machine s'est remise en marche, j'ai su que cette
fin constituait en réalité mon début. Il s'agissait d'une série de jeux de mots
sur mon nom. C'était en quelque sorte ma signature (pourquoi devrait-on signer
à la fin ?). Comme l'a dit Barthes, c'est mon identité que je décline avant de
commencer à jouer.
Votre
carrière littéraire, depuis Une curieuse solitude,
patronné par Mauriac et Aragon, semble accuser de curieux zig-zags.
Ph. S. : Une curieuse solitude, je l'ai supprimé de mes bibliographies. Ce
petit bouquin écrit à dix-neuf ans en deux mois et demi est un plagiat. Même le
titre n'est pas de moi. Le Parc est,
lui aussi, un très mauvais livre. D'ailleurs, il a eu un prix littéraire. La
vérité, c'est que je suis resté longtemps un peu demeuré. Mais pourquoi
l'authenticité devrait-elle être immédiate ?
C'est autour de 1968 qu'il s'est
passé quelque chose. Il y a eu une levée de la censure. C'est alors que j'ai
soudain renoncé à chercher une langue utopique qui pouvait tout dire tout en ne
disant pratiquement rien pour me lancer à corps perdu dans la forme du jeu. Je
dois à la vérité d'ajouter (je ne sais si on peut l'imprimer mais c'est
important) que c'est souvent écrit de façon systématique avant, pendant, ou
après des expériences d'états hallucinatoires. Prenez le titre H, vous entendez le son. Cela coupe. Il
y a, bien sûr, le poème de Rimbaud. Mais il y a surtout le hash. Un peu avant Lois, je me suis mis à prendre un
certain nombre de produits : pas tellement le L.S.D., mais plutôt le haschisch,
la marijuana, les herbes, avec des effets très différents les uns des autres.
Mais attention, là encore, l'essentiel n'est pas tel ou tel produit chimique, mais
le fait d'attraper le fonctionnement musical de la langue, cet état que nous
passons notre temps à refuser dans la communication dite normale. Pourquoi ce
refus ? À cause du refoulement sexuel.
Pensez-vous
que cette manière de travailler soit compatible avec vos conceptions
révolutionnaires ?
Ph. S. : Oh ! vous savez, je ne crois pas du tout à cette idée du lecteur tombé du ciel et communiquant
directement avec un livre. Je pars d'un principe très opposé : on est immergé,
qu'on le sache ou non, dans la réalité historique et inconsciente. Même si le
lecteur de la rue ne sait pas qui est Hegel, toute sa vie n'en est pas moins
influencée par la dialectique. Alors, s'il y a une révolution, elle doit passer
par le langage. Mon seul problème c'est d'écrire une langue assez vivante,
assez moderne, assez populaire (quoique cultivée) pour provoquer le choc
immédiat.
Le Monde du 29 novembre 1974
Propos recueillis par Jean-Louis de Rambures
|