|
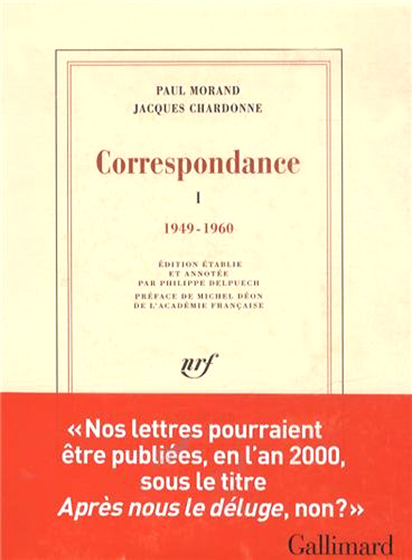 |
 |
| |
Paul Morand
|
|
|
|
Paul Morand sur Proust
1. vidéo de Pierre-André Boutang. 2. Document de 1962
|
Un Français à New York
La vivacité de Morand est de
nouveau parmi nous, on ne s'en plaindra pas. C'est tout de même étrange, ce
sommeil ambiant. D'où vient-il ? Que veut-il ? Où va-t-il ? De la lenteur,
encore de la lenteur, vers la lenteur. Une accélération pour rien, un
ralentissement sans jouissance. On dirait un programme. C'en est un. Mais
masqué. Personne n'irait l'appeler par son nom, l'éternel esprit de pesanteur,
sans risquer d'être désigné comme fou, camé, speedé, et j'en passe. N'employez pas plusieurs mots à la fois. Évitez
les reparties trop vives. Vous avez vos réflexes instantanés bien stéréotypés ?
Votre bonne mauvaise pensée bien pesante? Vous pouvez la montrer? Il vaut
mieux. Taisez-vous et rentrez chez vous. On vous filtrera les nouvelles.
Parfois, Morand semble écrire un
peu n'importe quoi, c'est un surréaliste sec. Il est tout en mouvements, en
raccourcis, cavalier surprenant et sûr. C'est l'art de la nouvelle, justement,
lendemain de guerre, il s'en explique très bien dans sa préface de 1957 à Ouvert la nuit. « La nouvelle se porte
bien ; elle est en train d'échapper aux périls où le roman est exposé
(occupation du terrain par les écrivains philosophes, dissociation du moi,
effondrement du sujet après celui de l'objet). La nouvelle tient bon grâce à sa
densité... La nouvelle est une nacelle trop exiguë pour embarquer l'Homme : un
révolté, oui, la Révolte, non. » Et encore : « J'essaie de me revoir tel que
j'étais en 1922, au moment de mes premières nouvelles. Écrire me paraissait la
forme la plus naturelle de l'appétit, de la jeunesse, de la santé... L'idée de
durer littérairement m'apparaissait négligeable, plus que négligeable, obscène
; la pudeur et l'élégance de l'époque exigeant des adieux sans larmes à une
civilisation moribonde. Un simple faire-part. »
Partir, écrire directement, ne pas
se préoccuper des résultats, avoir la cible bien nette en tête, et une main qui
ne tremble pas : la forme s'ensuit, qui arrive à destination quel que soit le
contexte de l'agonie en cours. La preuve, vous ouvrez ces livres, ils sont
immédiats : « Depuis trois soirs on la voyait. Elle était seule, sauf pour les
danses, qu'elle ne manquait pas, mais avec le professeur ou des copines. » Ou :
« Sur cette côte abrupte, un bonheur plat commença. Un bonheur sans téléphone.
» Ou bien : « L'Orient-Express traînait dans la nuit son public tri-hebdomadaire. Le même toujours. » Ou encore : «
J'allais voyager avec une dame. Déjà, une moitié d'elle garnissait le
compartiment. » L'attaque brève, le développement par saccades (souvent
jusqu'au procédé), le dialogue à la limite de l'absurdité, le saut rapide
au-delà de la description, la caméra faussement négligée, la chute. Somnambules ou languissants,
s'abstenir. Tout est de la même encre, le merveilleux 1900, par exemple, qu'il faut relire en le transposant aujourd'hui;
ou Hiver Caraïbe ; sans parler de la
mitrailleuse d'Hécate et ses chiens,
récit au galop à travers la perversion claquante, la phrase comme voyage
instantané (« un continent par jour, voilà notre foulée »), sujet de la folie refoulante s'emballant dans le temps (« J'étais de
naissance, de tempérament et de formation, huguenot. Bienséance, Convenance,
Décence, ces trois fées réformées me suivaient depuis le berceau »). D'où un
humour électrique, la diversité des étonnements, le sang-froid des
observations. Préfacé par Marcel Proust (comment ne pas en mourir ?), le
Diplomate contemporain de Claudel (comment survivre aux dossiers ?), le
Demi-exilé de Vevey (c'est son côté Chaplin), l'Académicien (comble de ruse
historique) est là, devant vous, dans une jeunesse éternelle, celle de la
syntaxe et du coup de fouet verbal. C'est sans doute le meilleur écrivain
français du vingtième siècle, en retrait de Proust et de Céline, bien sûr
— il a compris ses limites —, mais loin devant les autres dont
l'inutilité s'accroît chaque jour. Allons, au trot. Pas une minute à perdre. Et
puis, un écrivain informé en vaudra
toujours mille au moins. Tant pis pour ceux qui croient que leur existence
suivra leurs fantasmes. On n'a qu'une vie. Elle est plus ou moins vécue et
panoramique. Moteur.
Donc : New York. À part le passage
fameux de Voyage au bout de la nuit,
on ne peut pas dire que la littérature française se soit illustrée dans cette
dimension redoutable. Vous êtes à New York ou vous n'y êtes pas. Un Français,
en général, n'y est pas. Et pour cause. Il sort de sa province, il lui est déjà
difficile de connaître Paris, il méprise Balzac, l'imprudent, il croit que
Proust appartient au passé copiable, son système nerveux, abruti par
l'enseignement ou la dépression « moderne » instaurée en question de cours,
tournera un peu autour de Columbia ou de New York University...
On sera gentil avec lui, il comprendra vite qu'il n'a pas lieu, qu'il n'aura
jamais lieu, — sans se rendre compte que c'était déjà fini au départ et, sans aucun doute, par sa
faute. Il faut se débrouiller seul, à New York, sans papiers, sans garantie,
sans réseau de soutien autre que factice. N'attendre rien, aucune
reconnaissance, travailler pour soi. Tu n'es pas plus démuni, après tout, qu'un
des dinosaures américains arrivant à Paris dans les années vingt. Problème de
concentration physique. Tu verras plus tard, little French, à bientôt.
Morand a vite vu, compris, dessiné
la situation. Le livre est publié en 1930, moment du grand tournant :
économique, technique, géopolitique. Il est un des seuls Européens à saisir
l'événement. D'où sa tentative de le maîtriser, dans un livre qui est à la fois
un essai de mythologie, une prophétie nerveuse, un guide touristique, un
reportage, un traité d'ethnologie, une longue nouvelle. Le New York de Morand
est un peu comme le Londres du Pont de
Londres de Céline. Que ne sont-ils restés tous les deux de l'autre côté du
Channel ou de l'Atlantique au lieu de se mêler à l'explosion du Vieux Continent
! Une tout autre histoire de la littérature aurait pu se dérouler alors.
Replantons un instant le décor : l'entre-deux-guerres, le fascisme et le
stalinisme, les deux pôles d'attraction que sont, pour les intellectuels et les
écrivains, Berlin et Moscou... Ces deux dernières villes n'étant d'ailleurs
(Morand dixit) que des « New York
ratés », — jugement d'une lucidité singulière au moment où la boussole
s'affole... Mais il va être trop tard : l'idéologie a frappé, l'horizon
philosophique de propagande d'un côté, la maladie raciste et antisémite de
l'autre (dont on va trouver les traces révélatrices même dans ce volume en
apparence si « détaché »). Céline va s'enfoncer dans la malédiction de ses Bagatelles qui l'entraîneront de
l'Allemagne jusqu'au Danemark. Elle sera loin, la fée Virginie du Pont ! La
féerie des parcs ! Le rythme gratuit à rouler de rire ! Quant à Morand, il
sera, lui aussi, du « mauvais côté » — et nous serons obligés, nous,
citoyens moraux, de subir l'emphase pseudo-métaphysique de Saint-John Perse ou
de Char, les romans surfaits d'Aragon, les pièces bétonneuses de Sartre, la
prose compassée de Camus. Le manichéisme à bascule prendra possession de
l'appréciation du langage : Droite /Gauche ça dure encore. Marche titubante et ruineuse, chacun les siens, je ne vous parle pas,
je ne vous lis pas. Il est à craindre que le siècle finisse sur ce Une/Deux !
— tournant de la tragédie à la farce. La critique littéraire est devenue
leçon de civisme et nous aurons de plus en plus de bouffons politiques
sinistres par refus de penser l'au-delà du goût. Tant pis. S'il n'y a plus
qu'un lecteur, lecteur, vous serez celui-là, n'est-ce pas ? Vous emporterez
bien quelques livres avec vous pour voir, à l'usage, loin des demandes de vote
et de pétition, ce qui tient le coup ?
D'autant plus que le problème, aujourd'hui, n'est plus l'émergence de New York
: New York est, en un sens, partout et nulle part. À Tôkyô, à Rio, à Mexico,
demain à Pékin (j'ai rêvé au Pékin de 2050 dans la Cité Interdite)... Et c'est
ainsi que resurgit la vieille Europe et, en premier lieu, Paris. Si on écrit
encore des livres — mais oui —, ils porteront la cicatrice de ce
bouclage géant, chaotique, en même temps que d'un bizarre retour au calme,
comme si rien ne s'était passé. Il ne se passe jamais rien, d'ailleurs. Sauf
que ce rien va à toute allure. Voyez Proust soucieux, dans Le Temps retrouvé, de mettre La Recherche dans la perspective bouleversée de la Première Guerre mondiale : bombardements,
uniformes, hôtel de passe nouveau, éclatement au grand jour de l'homosexualité
générale (comme si la mort de masse la révélait), décomposition accélérée des
personnages, recomposition des intérêts dans l'amnésie, selon les mêmes actes
d'aimantation secrets... Et Céline, dans Maudits
soupirs pour une autre fois, virtuosité poignante du concert verbal, à
Montmartre, sous de nouvelles bombes... Chassé-croisé avec les Américains ?
Hemingway à Cuba, Pound à l'asile, Faulkner replié au Sud... Montparnasse, New
York... Artaud du Mexique à l'Irlande, puis à Rodez... L'histoire des
migrations littéraires reste à faire, il nous manque la vue du Temps déplacé.
On sent bien l'ambition de Morand,
dès les premières lignes. Reprendre le récit là où Chateaubriand l'a laissé...
« Silence. Les dernières vagues atlantiques se jettent sur une pointe de
rochers bruns pourpres et s'y déchirent »... Nous entrons dans une
superproduction. Il faut être à la mesure de l'audiovisuel qui s'annonce. Et
pour régler ce New York déjà énorme, incontrôlable, le mieux est d'en raconter
la naissance misérable, hasardeuse, locale. Pour comprendre, comme magiquement,
son expansion et son évolution foudroyante, on en récite l'origine mythique.
Construction simple, la ville s'y prête : en bas, au milieu, en haut. J'ai
habité chacune de ces trois villes dans la ville : les quais de l'Hudson et
leurs soirs rouges ; la 28e Rue et son air d'Europe ; Morningside Drive et les mouettes planant sur Harlem... Le
grand changement (j'arrive là en 1976), c'est que j'ai connu une ville «
apaisée », enfin victorieuse de la planète, en train de s'arrêter pour se
contempler. L'élégant World Trade Center est maintenant là pour longtemps, en pointe. Plus de frénésie comme dans les
années soixante et cinquante (« tu
arrives trop tard, ça repart dans l'autre sens », me dit une amie dans
l'avion). New York est en plein vol, la bonne technique, pour un insecte
humain, est de s'y glisser sans bruit, de prendre sa distance intérieure, de
rester chez soi, d'écouter en profondeur. Petit appartement anglais de Jane
Street, dans le Village, je pense à toi... Aux terrasses du vingtième étage
bourrées d'antennes... Confort des fauteuils de cuir, soleil violent dans les
plantes vertes, c'est là que j'ai écrit, dans une solitude quasi totale, la
plus grande partie de mon Paradis...
Je finissais par sortir, je prenais des taxis en tous sens, j'ailais dormir au
début de l'après-midi sur les quais de planches où passaient des hallucinés du
jogging, éclat de l'été indien à New York, je rentrais tard, télévision de
nuit, marges espagnoles, une seule réalité : le dollar et l'espace ouvert, sans
limites. Il y a désormais un New York définitif, électronique, sans grand
intérêt, sauf pour une aventure intime. Le Français ne l'a pas encore compris :
il arrive, coincé ; personne ne fait attention à lui, il disparaît ou
s'enrhume. Il s'ennuie. Et pourtant rien de grave puisque, précisément, il ne
se passe rien. Le rien scintillant de New York est le programme de la Terre. Le
Messie est venu, il s'appelle régulation technique. Ce n'est pas possible ! Le
Temps doit aller quelque part ! Mais non. La bombe a explosé de l'intérieur :
répétition, annulation incessante de tout par tout. Débrouillez-vous avec cette
apocalypse tranquille.
Tranquille à présent, c'est-à-dire qui a digéré la violence qui l'a constituée
et continue, mais invisible, de la nourrir. Morand tente bien de s'appuyer sur
Whitman et ses visions, il essaie de penser que, comme New York a eu un début,
il pourrait avoir une fin... C'est le moment où, séduit, il doute, il rêve d'un
effondrement possible... Mais il sait qu'il n'en sera rien : « New York est ce
que seront demain toutes les villes, géométrique. Simplification des lignes,
des idées, des sentiments, règne du direct. » Si l'on cherche la complexité et
la complicité en dehors de soi, alors, en effet, c'est terrible. Le collectif
est réduit à sa plus simple expression, dissous. Attendre quoi que ce soit des
autres, et on est effacé sur place. Mais quelle
liberté, justement ! Quelle chance de méditation ! Mieux que dans un désert,
bien sûr. L'hallucination, ici, est vaincue par tous les moyens et « la grande
ville est le seul refuge contre l'intolérance, l'inquisition puritaine »... Les
États-Unis, sans cette grosse pomme de New York, seraient (et sont le plus
souvent) un pays de plomb religieux. Il fallait une formidable mécanique pour
user toutes les contradictions, les croyances, les velléités régressives
— les phénomènes, quoi. C'est fait. L'intérêt du « Morand » est d'enregistrer
le moment exact où c'est en train de se faire. Les gratte-ciel : « ils
s'affirment verticalement comme des nombres, et leurs fenêtres les suivent
horizontalement comme des zéros carrés, et les multiplient... La rage des
tempêtes atlantiques en tord souvent le cadre d'acier, mais, par la flexibilité
de leur armature, par leur maigreur ascétique, ils résistent... Aveuglé par
l'Atlantique ensoleillé, je me trouve en plein ciel, à une hauteur telle qu'il
me semble que je devrais voir l'Europe ; le vent me gifle, s'acharne sur mes
vêtements ; près de moi des amoureux s'embrassent, des Japonais rient, des
Allemands achètent des vues; comment décrire de si haut cette métropole en
réduction, c'est de la topographie, de la triangulation, non de la littérature
». Mais si, c'est encore de la
littérature, la preuve. Depuis le « vieil océan aux vagues de cristal » de
Lautréamont, ou « Les Ponts » des Illuminations de Rimbaud, les phrases se poursuivent, roulent, se pressent. Il vaut mieux ne
pas avoir le vertige, Morand ne l'a pas. Sa prose, éprouvée par la nuit
voyageuse, résiste, elle aussi : « Les gratte-ciel s'élèvent, sur une ligne,
pareils à des lamaseries dans un Lhassa inexpugnable »... Broadway, la 5e Avenue, la Bourse, la Presse : il note bien la nouveauté spatiale et temporelle
de la circulation de l'argent et de l'information (qualité essentielle pour un
écrivain), son projet de réseau mondial, sa vitesse, ses volumes. « En quelques
secondes, j'apprends que dans cette journée où, pour moi, il s'est passé si peu
de chose, le quatre-mâts Lucifer a
été coulé, que le premier prix d'Exposition d'horticulture cubaine a été donné
à une plante cobra, que le sénateur Lafolette est
champion de bridge de Miami et que les Musulmans se sont révoltés, il y a trois
heures, aux Indes. » Rien de bien différent aujourd'hui où, allongé sur son
lit, jetant un coup d'œil de temps en temps sur l'écran rose, un habitant peut,
avec Reuter News, lire en lettres
blanches tous les télex, suivre en bleu, en haut, le cours des monnaies en fonction
du dollar, et en bas, en vert, les prévisions météo (cloudy !). Le tout sur fond de musique classique : par exemple (ça
m'est arrivé) Prélude à l'après-midi d'un
faune, de Debussy. La discothèque compacte universelle rythmant les
événements, quoi de mieux ? Une catastrophe aérienne ou une guerre changent
évidemment un peu de couleur selon qu'il s'agit de Vivaldi ou de Wagner, mais
qu'importe ? Vous êtes mort depuis longtemps vous-même, et tout le monde avec
vous. Vous n'avez qu'à profiter de ce surplus de perception accordé au temps
atomique. Si vous mettez le nez dehors, l'Océan vous rappellera que vous êtes
en vie, mais dans d'étroites limites physiques, dans un espace hyperdilaté. Le climat de New York, d'un extrême à l'autre, froid coupant et enthousiasmant, chaud
accablant et tuant, c'est le rappel de la relativité générale. L'Atlantique a
raison depuis toujours, c'est bien mon avis. Et puis, en été, Long Island est
tout près, on part le vendredi soir pour Southampton, Easthampton...
Week-end à Bellport... Langoustes, glaces, champagne... « Toute
élite qui arrive au luxe aboutit au français. » Est-ce encore vrai ? Mais oui,
courage. Malgré les vins californiens, les bordeaux gardent leurs positions. Et
ils les garderont, malgré les attaques que l'on sent violemment intéressées,
jalouses... Le fait de ne mettre en avant, à New York, que des écrivains ou des
artistes français cafouilleux, timides (« il ne se passe rien en France ») fait
partie de ce complexe profond, durable, alerté... Du bon français ? En voici
encore, du côté de Washington Square : « Je retrouve les maisons rouges du
square, à portes et à volets verts ; le soleil de l'après-midi les gaine, comme
des meubles de l'époque, d'un velours magenta. » Un vrai café, au Reggio, en l'honneur de Morand, pour le mot magenta !
Ce que Morand perçoit, ne voit
qu'en partie — ne peut pas discerner complètement —, c'est la
nouveauté fantastique de New York quant au réglage des populations qui
l'irriguent, la grande expérience d'intégration et de mixité ethnique dont
l'Europe — et singulièrement la France — hésite encore à tirer la
leçon. Leçon pourtant irréversible. Et c'est ainsi que ce New York comporte des passages hautement symptomatiques dès qu'il
s'agit des Juifs ou des Noirs. De même que l'Affaire Dreyfus date la Recherche du Temps perdu, et Bagatelles, Céline ; de même les
réflexions que l'on trouve ici, en 1930, prouveraient, s'il en était besoin, à
quel point ce « thème » est celui du vingtième siècle, au même titre, diront
les historiens de l'avenir, que le nihilisme quotidien, l'homosexualité ou la
drogue, sans parler, vers la fin, des greffes, du sida, de la procréation
artificielle et de ses répercussions biologiques, éthiques et pathétiques. Rien
ne sert de s'indigner, il faut rire à temps. Mais ce n'est pas sans malaise
(malaise par rapport à Morand qu'on aurait pu croire, à tort, plus en éveil par
anticipation) que l'on lit la description de « cette population grouillante,
crasseuse, prolifique et sordide... Un immense folklore local, dans le théâtre
yiddish américain comme dans le roman, ressasse à l'infini la scène du vieux
père, inassimilable et botté, avec ses rouflaquettes grasses s'échappant de son
melon verdâtre, le Talmud sous son châle de prières, maudissant en russe ses
enfants devenus américains, qui ne le comprennent plus ». Ou encore : « Il est
neuf heures du soir. À cette heure-ci où sont les Juifs ?... Ces publics,
femmes en cheveux, hommes sans cols, cheveux crépus, yeux éclatants, bouches
charnues, teints livides, me transportent soudain dans les théâtres actuels de
Moscou : pas une retouche à faire, rien à changer... » Rien à changer, en
effet, à la bonne vieille perception antisémite du monde, dont les Français se
seront faits (point à élucider) une spécialité nationale, au point de pousser
littérairement le genre jusqu'à ses extrêmes. Visite à un journal : « J'arrivai
enfin au bureau du directeur. M. Ochs ressemble un peu à Lord Rothschild et un
peu à Max Jacob. M. Ochs m'expliqua d'abord, avant de m'avoir fait asseoir, que
les Juifs sont une grande race. Ensuite, il me mena à la fenêtre... » Ou encore
: « Ici tout est bon marché, clinquant et camelote, sauf les boutiques d'objets
religieux : quand il s'agit d'acheter un Talmud, un chandelier de cuivre, un
châle, un calendrier rituels, rien n'est trop cher. Une odeur de saumure et de
bottes graissées couvre tout. Jesus saves ! s'exclament les
affiches de l'Armée du Salut. À d'autres! Au-dessus de cette foule pauvre, mais
qu'on devine parfaitement satisfaite de son sort, étincelle un mot magique, qui
domine tout : " DIAMANTS ". »
Une fois de plus, nous sommes en
1930, mais cette « couleur » se passe de commentaires. Morand, décidément,
n'était pas grand lecteur de la Bible.
Nous sommes habitués à ces dérapages, on les trouve, plus ou moins marqués, à
peu près partout, et on devrait plutôt se demander pourquoi le terme de «
révisionniste », qui a été une scie de la langue de bois communiste, s'est
d'abord appliqué aux dreyfusards pour désigner maintenant les pseudo-historiens
attachés à nier le génocide des Juifs par les nazis. Morand antisémite ? Sans
plus, en passant, de façon paternaliste. On a vu pire. Là où nous sursautons
encore, c'est en arrivant à Harlem : « Le wagon [du métro] s'est changé en un
wagon de nègres ! Suspendus aux poignées de cuir par une longue main noire et
crochue, mâchant leur gomme, ils font penser aux grands singes du Gabon. » Non,
mais ! L'angoisse du crochu : traité
à faire. Je repense, moi, à mes nuits au Sweet Basil sur la 7e Avenue : si un groupe humain, hommes et
femmes, pouvait incarner l'élégance immédiate, c'était bien la population
noire. Résumons : une bonne Bible (j'ai toujours celle à couverture de cuir
vert sombre que j'ai achetée là-bas), et le jazz : deux tests, deux façons
d'éviter l'erreur. Et pas l'une sans l'autre (et réciproquement). D'ailleurs,
Morand serait sans doute surpris : il a écrit cela en courant, sans acrimonie
particulière, sans haine. Sauf que ce sont des stéréotypes et qu'un écrivain,
en principe, ne devrait pas s'en permettre un (ou alors, mis en abîme). Poids
des conversations et des imprégnations collectives. Autant on peut admirer
qu'un individu puisse dire à ce moment-là, au milieu de tant de délires : « Je
crois que les forces spirituelles de l'humanité ne sont pas l'apanage d'un pays
ou d'une race, mais de quelques hommes, de toutes origines, réfugiés sur un
bateau qui fait eau : là où la coque me semble encore la plus solide, c'est aux
États-Unis » (Mussolini et Staline sont déjà là ; Hitler arrive), autant on
peut s'étonner qu'il se contredise aussitôt : « Nous pensons à New York avec
orgueil... C'est nous, race aryenne, qui avons fait cela ! » Étrange, puisqu'il
écrit aussi : « L'Europe, cette mère, a envoyé à New York, au cours de
l'histoire, les enfants qu'elle désirait punir : d'être huguenots, quakers,
pauvres, Juifs ou simplement des cadets. Elle a cru les enfermer dans un
cabinet noir, et c'était l'armoire aux confitures ; aujourd'hui ces enfants
sont gros : ils sont le centre de l'univers »... Dont acte ? Sur le fond ?
New York n'était pas prévu au
programme religieux et philosophique : le phénomène a eu lieu quand même, et on
pourrait faire l'histoire du vingtième siècle en montrant que c'est de ne pas
vouloir le savoir que la folie a gagné des individus et des continents entiers.
Répétons-le : Morand est presque seul, parmi les Européens lucides. J'aime ce
paragraphe parce qu'il dit bien l'explosion comme le déracinement général de
l'époque : « New York est surchargé d'électricité. On se déshabille la nuit au
milieu des étincelles, qui vous crépitent sur le corps, comme une vermine
mauve. Si l'on touche un bouton de porte, un téléphone, après avoir frôlé le
tapis, c'est une décharge ; on a des éclairs bleus au bout des doigts... "
Je vous serre la main à distance, m'écrivait Claudel de Washington, heureux de
vous éviter une commotion. " » On comprend que Morand fasse de la Batterie son centre d'exploration. Mais
New York, aujourd'hui, est moins nerveux que Paris, c'est plutôt une ville
douce, spacieuse, taxis jaunes qui s'arrêtent, libres, dès qu'on lève le bras,
je me suis demandé cent fois si j'allais décider de vivre en partie là-bas, New
York, Paris, l'Italie, triangle fondamental. Contrairement à ce que pensent
ceux qui, des deux côtés de l'Atlantique, auront toujours dix ou vingt ans de
retard, c'est New York maintenant, qui redevient peu à peu la province, immense
et technique, soit, mais appelant le séjour, la villégiature, le repos.
Regardez Morand : il est tout le temps dehors,
il ne rentre que pour sortir, il découvre un espace privé d'intériorité,
vaporisé, projeté en l'air. Mais on peut à présent passer des jours enfermé,
monter sur les toits et les terrasses s'il fait trop chaud, écouter le silence
poudroyant de la ville, suivre la course immobile du soleil qui a l'air de ne
jamais se coucher — hauteur du ciel qui, à Paris, « pèse comme un
couvercle », vent tordu comme un mauvais linge du bassin parisien —, se retirer chez soi, donc, avec l'Océan et
une bonne bibliothèque comme sauvée des eaux. Le confort de New York est
monumental : rien ne semble le menacer. Davantage de temps, loin de tout, pour
regarder la peinture. À la Frick Collection, par
exemple, où tout à coup, un jour de novembre, j'ai vu comme pour la première
fois, Fragonard, les panneaux de Louveciennes refusés par Madame du Barry à
qui, par leur liberté de mouvement, ils donnaient sans doute le vertige.
Craignant de perdre la tête en regardant ces peintures sur ses murs, elle l'a
perdue tout à fait, plus tard. Fragonard ou Robespierre : il fallait choisir. «
New York sera le centre de l'Occident, le refuge de la culture occidentale »,
dit à Morand un de ses interlocuteurs. Il y a, en tout cas, beaucoup de
dix-huitième français à New York, dans les collections privées. La fable de
l'art moderne, c'est pour l'extérieur : tout en haut, on stocke Louis XV.
Madame Bartholdi, en statue de la Liberté, nous prévient de ne pas accorder
trop de crédit au kitsch ambiant. Déesse du kitsch, oui, elle l'est, mais sans
conséquences. Il y a plusieurs marchés concentriques ou parallèles, et les
valeurs, quand il le faut, sont exactement pesées. « New York, écrit Morand, va
avoir bientôt son musée d'art moderne »... Prestigieux MOMA, mais qui, lui
aussi, semble aujourd'hui saturé, comme s'il avait pleinement rempli sa mission
historique. Le point de retour — avec toutes ses répercussions visibles et invisibles — porte un nom : Guernica. Picasso et Matisse ont
déclenché la peinture américaine (Pollock, De Kooning, Rothko), mais cette
dernière est-elle allée plus « loin » qu'eux ? Eh non, tout le monde le sait,
mais c'est une vérité qui blesse le grand fantasme new-yorkais : table rase et
nouveau calendrier à partir de 1939. Maintenant, Guernica, à Madrid, surplombe le Prado, et il s'agit là d'une des
plus étonnantes victoires de l'art sur la guerre, la politique, l'idéologie, la
démence humaine. Il ne reste plus au MOMA que cet autre symbole capital du
renouvellement des formes : Les
Demoiselles d'Avignon (que je suis allé voir presque tous les jours pendant
trois mois). Qu'elles reviennent elles aussi en Europe, les Demoiselles, et le
tour sera joué. Le tour du monde, enfin, de la petite planète où nous sommes.
Le musée Picasso à Paris ? C'est la limite même de New York (où d'ailleurs, Picasso, pas plus que Joyce, n'a jamais mis
les pieds). Un coup dur pour la fondation de la nouvelle ère... Le calendrier
grégorien reste ce qu'il est : inamovible malgré la Révolution et les Nouveaux
Mondes. Fragonard, Picasso : deux boussoles pour le civilisé anesthésié par les
proclamations futures, futuristes, futurisantes. Les mousquetaires ironiques du dernier Picasso
? La chapelle de Matisse à Vence ? Deux défis conscients à l'art « moderne ». Une désorientation exorciste et
volontaire du Temps.
L'épopée de New York est donc
terminée : elle aura signifié, dans un pli de l'histoire voué à la mort, une
volonté de vie, de survie, d'invention sans précédent et probablement sans
suite. Ce qui va avoir lieu, on le pressent : un réglage tous azimuts par rapport à cette surrection dans un
naufrage quasi général. Une mise au point longue, lente,
patiente, pleine de conflits, de freinages, de régressions transitoires.
En ce sens, oui, le « calendrier » a changé. Jérusalem est là, ce qui ne veut
pas dire pour autant la fin de Rome. L'islam sortira-t-il du Moyen Âge sans
destructions inouïes ? Les Chinois, comme les Japonais, viendront-ils de plus
en plus nombreux voir l’Olympia de
Manet à Paris ? On l'imagine. On l'espère. On écrit dans ce sens. En attendant,
New York restera pour longtemps en avance sur le mouvement horloger planétaire.
C'est en dollars que nous pensons, plus ou moins consciemment. La vie suit son
cours, qui n'est rien d'autre que la démonstration complexe et permanente de
l'échec des exclusions, des refoulements, des volontés de ne pas savoir.
L'exclu prospère de l'injustice dont il a été l'objet (à grandes injustices,
grandes victoires) ; le refoulé fait forcément retour, c'est une loi ; la volonté de ne pas savoir se fissure, est obligée
d'abandonner une forme de censure pour en inventer une autre. On ne « lève »
pas le refoulement, mais il se déplace, c'est ce que semble dire, en même temps
que le vieux Viennois, l'aventure appelée New York. Morand écrit : « Rien ne
peut détruire Paris, nef indestructible. Paris existe en moi : il existera
malgré Dieu, comme la raison. » Comme si « Dieu » n'était pas, tout comptes faits, la raison même ! Ce
doit être pour ça qu'il semble monopoliser, périodiquement, toutes les folies.
La raison a son dieu que Dieu et la Raison
ignorent ; New York paraissait déraisonnable, une crise urbaine sans
lendemain, au moment où l'Europe allait s'engager dans un énorme suicide
collectif ? Simple pulsion anticipatrice, vases communicants, thermodynamique
secrète. Il fallait drainer, sauver, entreposer, surgreffer et multiplier un résultat encombré de deux siècles, pour pouvoir passer à la
spirale suivante, celle qui nous attend.
Je peux donc rêver qu'ils sont
tous embarqués ensemble et réunis pour une soirée là-bas : Proust, Picasso,
Céline, Matisse, Claudel, Morand, Giacometti, Artaud, Breton, Drieu, Aragon, Bataille... Certains ne veulent pas se
parler ? Mais si, voyons, le vaisseau est déjà au large, la traversée sera
longue. On a laissé en deuxième classe les savants et les professeurs, les
différents philosophes montés en première à la faveur des destructions de la
guerre. Pas de journalistes. Ni radios ni télévisions. Entrent maintenant dans
le bar immense : Joyce, Pound, Kafka, Faulkner, Hemingway, Borges, Nabokov. Il
y a plein d'hôtesses ravissantes. La grosse dame, dans un coin, que Picasso
crayonne d'un trait sec et cruel, c'est Gertrude Stein sur qui se penche le
spectre noyé de Virginia Woolf. Le Midnight : c'est ainsi que s'appelle le restaurant du 2003, lointain successeur du Demi-Lune hollandais commandé par
l'Anglais Hudson, nouveau Titanic intergalactique en train de revenir vers l'Europe. Le personnel est impeccable
: sévère maître d'hôtel (Samuel Beckett), chef de rang farceur (Alain
Robbe-Grillet), sommelier réservé (Claude Simon), vestiaire méditatif (Michel Butor),
liftier imperturbable (Robert Pinget), dame de compagnie charmante (Nathalie
Sarraute), caissière impériale (Marguerite Duras). Ils ont tous été recyclés et entraînés
au Lindon's Club par un steward native, Tom Bishop, ex-correspondant du
petit noyau dur Verdurin. Il est déjà question de
former des garçons plus jeunes, bien décidés à marquer leur place le plus vite
possible, comme au grand hôtel de Balbec. Tiens,
voilà Milan Kundera avec Philip Roth. Et Thomas Bernhard, qui a l'air irrité
contre Samuel Beckett. Peter Handke voudrait bien, timidement, échanger
quelques mots avec Marcel Proust, mais ce dernier (incontestable vedette de la
soirée) écoute, sans réagir, une improvisation hilarante de Kafka. Personne ne
paraît vouloir adresser la parole à Céline, je m'en chargerai donc, bien que
j'aie plusieurs questions de la plus haute importance théologique à poser à
Joyce (Proust, lui, m'a donné rendez-vous pour un entretien approfondi et
chaste, dans sa cabine, « plus tard »). Le pauvre Joyce semble d'ailleurs coincé par les Latino-Américains, les Africains et les
Japonais. Je tente de me frayer un chemin, au milieu des invités de plus en
plus nombreux, dont je ne peux pas citer tous les noms (noms d'ailleurs aboyés
sur le seuil par un solide huissier suédois dont le sobriquet, me dit-on, est «
Nobel »). Au passage, quand même, je félicite Morand pour son New York d'autrefois. « Je n'osais pas, me répond-il avec sa courtoisie
légendaire et chinoise, non, je n'osais pas rêver cet encens. »
Dix-huit heures quinze : les
mouettes crient, les cloches sonnent de partout dans le ciel rouge, au-dessus
de l'eau-mercure bouillonnante. Je pense à la 5e Avenue où il est
maintenant midi et quart : je marche vite, là-bas, dans le vent coupant, je
monte déjeuner au 666, en face de
Saint Patrick. Ici, en revanche, pendant que je bois mon whisky, le Diamond, bleu et
noir, de Panama, l’Orpheus blanc, d'Athènes, entrent lentement au port. Les messes recueillies du soir
commencent à Saint-Marc, à la Salute, au Redentore, à San Moise, à Santa Maria del Giglio, aux Gesuati, dans
l'ombre glissante. Nous avons droit au présent perpétuel. C'est le moment qui
nous vient.
Venise, septembre 1987
La Guerre du Goût, pp.56-75, folio n°2880
Le swing de Morand
Reprenons vers les années 20 :
tout aurait pu être différent, une autre histoire se laisse inventer dans
l’ombre. À un bal chez les Beaumont, Marcel Proust fait une apparition. Le
jeune Paul Morand, fils d’un artiste peintre, commence sa carrière protégée
dans les ambassades, après avoir été employé au Chiffre pendant la guerre.
Paris est le centre du monde : dadaïsme, cubisme, surréalisme, Picasso, Joyce,
Stravinski. Le temps, la nuit et les femmes changent de profondeur ; une
nouvelle civilisation se venge vivement du dix-neuvième siècle. La circulation
déborde, devient folle. Morand (« En 1925, chacun sa drogue. J’avais pour
stupéfiant le voyage »...) est partout et nulle part. On le voit à
Londres, à Bangkok, au Japon avec Claudel, en Chine, à Venise, en Afrique, aux
États-Unis. Image : en 1928, hommage rendu à Proust après sa mort, un bal a
lieu chez le prince de Faucigny-Lucinge. Morand est
déguisé en Charlus, sa femme en Mme Verdurin, Valentine Hugo (l’illustration manque) en Sodome
et Gomorrhe. Morand ? Il est déjà reparti. En 1934, il est en Italie avec
Josette Day, une actrice. Et puis en Égypte, en Arabie, au Yémen, en Irak, en
Syrie. En 1938, il représente la France à la Commission internationale du
Danube, à Bled, en Slovénie. Le style, c’est l’homme ; mais l’homme est
désormais très pressé. Tout bascule ? Non, le coup d’arrêt est donné
tragiquement pendant cinquante ans : Staline, Hitler, et la suite.
Morand, davantage par goût du
confort conjugal que par conviction, se retrouve du mauvais côté de l’Histoire.
Parmi d’autres signes pénibles, on est navré d’apprendre, par exemple, qu’il a
renoncé, en 1942, à une adaptation cinématographique de Nana parce que le sénile Pétain trouvait Zola immoral. Morand est
donc par la suite compromis, révoqué, mis à l’index, exilé, republié,
réintégré, refusé puis accepté à l’Académie, mornes secrets, molle affaire.
Admiré par les uns, censuré par les autres, jusqu’à ce que le combat cesse
faute de combattants dans la grande indifférence mécanique de la marchandise.
Et ses livres ? Après les années folles, celles de feu et d’abjection, celles
d’explosion et de plomb, celles de corruption et d’annulation, les revoici
devant nous. Sa prose a été l’occasion, dès le début, d’un des textes critiques
les plus importants de Proust : la préface, en 1920, de Tendres Stocks (rien que cette préface, et ses sous-entendus,
mériterait une longue analyse). La meilleure définition de son style est sans
doute celle que lui écrit Claudel (qui sera choqué par L’Europe galante comme, plus tard, monseigneur Grente par Hécate et ses chiens) : « Vous
allez vers les choses en trombe rectiligne. » Même André Breton est séduit
par cette irruption rythmique (mais Breton n’aurait jamais imaginé une phrase du
genre : « Je couche avec certaines femmes pour avoir avec elles des rapports
apaisés et confiants. »)
La nouvelle, dit Morand, est de
l’os. C’est la situation d’un narrateur sans cesse aux aguets, multipolaire,
immergé dans le système nerveux de l’époque : « Quand les mauvaises mœurs
sont publiques, elles doivent l’être aussi dans les livres. » Une attaque
descriptive ? Voici : « La matinée était très sucrée. La chaleur traversée
d’un vent frais qui relevait les robes. Les coqs chantaient. Personne n’objectait
rien à rien. » Clarisse, Aurore, Isabelle, Ursule, Daphné, ont l’air de se
réveiller ces jours-ci. Ce qui sent juste se conçoit clairement, et les
phrases, pour le dire, arrivent aisément avec les mots qui conviennent. Ni
pudeur ni impudeur, aucun larmoiement.
Avec son air
de cavalier chinois, Morand est l’amant français idéal, aux antipodes du
parvenu en limousine ou de l’empoté exotique. Il a l’électricité jazzée de
Crébillon fils. Même brefs, les écrivains sont toujours trop lents,
pathétiques. Qu’est-ce qui excite une femme ? Lisez Céleste Julie ! Comment peut-on être le même homme en étant décrit
de façon si contradictoire par trois femmes ? Réponse dans La Glace à trois faces. Que dire, pendant un dîner, à la femme qui
aime la même femme que vous ? Leçon dans Les
Amis nouveaux. L’ironie est serrée, le dialogue souplement concurrent du
récit, on entend les voix, on capte les attitudes, le non-dit est un élément
moral. Cinq coups de pinceau : « J’eus la chambre 217. Elle était neuve et
sentait la colle. Un cafard traversa sans hâte le tapis. Dans un tiroir, on
avait oublié un as de trèfle. Je commandai un dîner pour deux. » Proust a
certainement lu avec étonnement cette séquence de Clarisse : « Dès que ma mère m’avait embrassé et bordé, je
sortais de mon lit. La fenêtre ouverte donnait sur le balcon et sur la rue. Ce
balcon était toute ma joie. Je sens encore sous mes pieds nus son plomb chauffé
par le soleil qui s’y attardait jusqu’au soir ; j’ai encore sur la langue le
goût frais de l’appui en fer que je léchais... » Morand se déplace, mais
il garde le mouvement sur place, la relativité généralisée. C’est la situation
elle-même qui regarde, écoute, dispose des volumes et des rapports de forces.
« Elle est plus fermée qu’une jeune fille, qu’un prêtre. Le secret
professionnel. Elle tient ses songes sous clef. Personne n’a jamais réuni
contre elle de preuves ou commencements de preuve. Elle ment quand il le
faut. » On peut, ces temps-ci, relire ce chef-d’œuvre : Je brûle Moscou. Mais toutes les nuits de
Morand sont brûlantes : « J’habite en elles comme au creux d’une caverne,
d’une noire erreur, seul, ou avec mes sœurs extravagantes. » Etrangeté de
la simplicité immédiate : « Je me déshabillai. J’éteignis. Il faisait
chaud dans le salon, une chaleur artificielle, sans agrément, au fond de
laquelle je fus forcé de m’endormir vite. » Ou encore : « Je
n’indiquerai pas toutes les conséquences que ce baiser eut pour moi. Il faut dire
qu’il était exceptionnel. » Ou encore : « En public, elle témoigna
délibérément que je n’existais pas. Jamais elle n’oublia de m’oublier. »
Morand est un des rares écrivains
non somnambules ou non hypnotisés de ce siècle qui aura connu beaucoup de
dormeurs et d’hallucinés. Peut-être à cause de cette confidence qu’on peut tenir
pour autobiographique, dans l’Éloge de la
marquise de Beausemblant : « Je suis une mer
fameuse en naufrages : passion, folie, drames, tout y est, mais tout est
caché. »
La Guerre du Goût, pp.338-342, folio n°2880
Morand, quand même
On peut décider d’être sévère avec
Morand, c’est facile. Le procès est vite expédié : les origines bourgeoises, le
succès, la fortune d’un riche mariage, Vichy, l’antisémitisme, la misogynie,
l’homophobie, l’Académie, l’absence de repentir, l’affirmation du bonheur physique,
l’« aristocracisme ». Brève déclaration du condamné
par avance : « Je suis un ultra, style Charles X, séparé de la masse française
par ma vie et mes goûts ; mais un ultra sans la foi ; et qui, contrairement aux
autres, a beaucoup appris et retenu. » Sans doute, Monsieur Morand, mais la «
masse française », comme vous dites avec mépris, est là pour vous juger et non
pour excuser votre vie déréglée, vos goûts surannés, votre aventure ratée.
Votre temps est passé, votre monde s’est effondré, nous avons changé d’ère. À
quoi bon rouvrir votre dossier ? Vous êtes incurablement d’un Ancien Régime
dont nous avons fait table rase. Votre cas est implaidable,
votre correspondance ou votre journal posthumes le prouvent. L’indulgence à
votre égard n’est pas de mise, ce serait renverser le verdict de l’Histoire.
Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui ? « Ce que j’ai réussi peut paraître
insignifiant ou médiocre, comparé à d’autres vies, mais c’est immense, ce fut colossal, si on
considère la médiocrité de ma personne, ma bêtise, ma paresse, ma vulgarité,
mon avance à tâtons, ma progression à l’aveuglette. Mon seul mérite, c’est de
le reconnaître avec sincérité et humilité, de l’avoir vu assez vite et assez
tôt, et d’avoir toujours rendu grâce aux autres et à la Providence, en disant
toujours que je ne l’avais pas mérité. »
À partir de là, forcément, on
écoute. Mais attention, ce condamné est rusé, beaucoup plus intelligent qu’il
ne le dit, nous n’allons pas nous laisser désarmer comme ça, ce serait trop
simple. Pourtant, il y a là, chez lui, un ton nouveau, un accent qui force non
pas la sympathie mais la curiosité. « Il ne faut pas que je meure parce que je suis un grand spécialiste, un
metteur au point, un poinçon d’authenticité ; quand je mourrai, l’Europe mourra.
Déjà elle est morte. Ce n’est plus la même. Mais je n’aurai pas besoin de rien
expliquer. Regardez-moi. » Soit, on le regarde : il faut avouer que, pour son
âge, il a l’air de tenir le coup. À plus de 80 ans, il conduit encore sa
voiture, il voyage sans arrêt, il « baise » (c’est son mot), il a abandonné le
ski mais part encore à la pêche en haute mer, il va tous les jours faire sa
gymnastique dans un club, voulant, dit-il, rester souple et musclé jusqu’à son
dernier jour. Le président : « Vous ne fumez pas ? » Réponse : « Cinquante ans
de cigares, puis j’ai arrêté... mais je compte reprendre à quatre-vingt-dix
ans. » Rires dans la salle. Le condamné enchaîne : « Que de vies ! Celle
de l’enfant choyé, de l’étudiant sans souci, du diplomate aimé des dieux, de
l’écrivain d’avant-garde, du Tout-Paris, du voyageur, du Don Juan, de l’exilé,
du proscrit revenant au pays, du romancier classique, de l’académicien, de
l’infirmier, du vieillard solitaire et abruti, du riche, du faste, du clochard,
etc. « Une vie de riche étoffe », dit Montaigne : plutôt du patchwork. »
Attention, attention : le condamné
commence à étaler sa vaste culture. Il est déjà inadmissible qu’il se présente
à la fois comme sportif et comme écrivain. Un écrivain, nous le savons et nous
le souhaitons, est un être souffrant, sentimental, tourmenté, mélancolique ou
au moins habité par le souci des autres, l’intérêt collectif. Vous allez voir
maintenant qu’il va nous déballer la bibliothèque. Avec l’évocation de son
existence cosmopolite et de ses rencontres (il a connu tout le monde), c’est
son numéro préféré. Et en effet, ça ne rate pas : le voilà intarissable sur
Saint-Simon, le cardinal de Retz, La Rochefoucauld, Molière, Stendhal, et j’en
passe. Certes, il lit comme personne, il repère immédiatement les formules
ramassées qui produisent le plus de sens. Il se vante, comme Saint-Simon, de «
savoir le joint des choses ». Mêlées d’anecdotes diverses et de portraits de
célébrités (Chaplin, Chanel, Gide, Claudel), ses citations condensent des livres
entiers, et le plus grave, c’est qu’on se laisse prendre à sa virtuosité. On ne
sait plus où on est : au XXe siècle ou sous Louis XIV. Brusquement,
il essaie de déstabiliser le tribunal : « Moi qui ne me suis guère senti de
racines, pendant soixante ans, et de moins en moins, comment ai-je pu me
fourvoyer à droite ? » Ici, quelques murmures. Mais l’animal va plus loin : «
J’ai longuement réfléchi sur l’attrait que Cohn-Bendit et les enragés de mai
1968 ont eu pour moi : mon point commun avec eux c’est la paresse. Jouir !
Toutes les révoltes commencent par l’ivresse et la satisfaction physique... »
Le président s’impatiente : « Mais enfin, Morand, où êtes-vous ? » Réponse : «
Ailleurs. » Le président : « Mais dans l’Histoire ? » Réponse : « L’Histoire, sur
laquelle notre début de siècle s’est tellement appuyé pour vivre et penser, ne
servira bientôt plus de rien, tant ce qu’on va voir (basé sur la technique et
non plus sur l’horreur) aura de moins en moins de précédents. » Le président :
« Que voulez-vous dire ? » Réponse : « Les Anglais nourrissent désormais la
volaille avec sa propre fiente déshydratée, produit qu’ils nous vendent : ils
ont donc trouvé le mouvement perpétuel et la solution de la question sociale :
il va nous suffire de manger notre propre merde. » Rires et applaudissements
dans la salle. Nous voilà bien.
Les témoins de moralité défilent.
Monsieur Marcel Proust, qu’on aurait cru plus vigilant, trouve le condamné
Morand plein d’intelligence, de sensualité, d’insolence et d’ironie. Quoique
regrettant que la sensualité du condamné se soit employée avec des femmes, il
le compare à « une grosse rose blanc crème » et à un « matou perspicace ». Il
le crédite de « beaucoup de maîtresses et de peu d’amis » tout en se déclarant
« l’admirateur de sa pensée, de sa perfidie, de sa gentillesse et de son talent
». C’est là un témoignage de poids, le public y est malheureusement sensible. Sa
femme, maintenant, Hélène ex-princesse Soutzo, amie
de Monsieur Proust, mais réactionnaire entêtée et antisémite notoire. Elle
défend son mari avec de grands airs, l’appelle « mon toutou », décrit son
dévouement pendant sa longue agonie, lui lance avec une complicité
incompréhensible : « Tu n’as jamais vécu que pour ton plaisir. » Le président
lui demande si les infidélités multiples de son partenaire ne lui ont pas été
douloureuses, et s’attire cette réponse : « Un homme qui ne trompe pas sa femme
n’est pas un homme ! » Rires dans la salle. Ici, le condamné rappelle comment
il faisait des bouquets pour elle de tout ce que contenait leur jardin :
« lilas blanc, pivoines, iris mauves et dorés, lupins, ancolies, boules de
neige, genêts, épines roses, rhodos, azalées du
Japon, dernières tulipes perroquets jaunes et rouges, grappes jaunes des faux
ébéniers ». Le président pense que ces deux-là sont complètement fous. Il
tente une percée vers Dieu, et le condamné se risque : « Je sens profondément
que je ne suis qu’un pion, placé à son insu entre Dieu et le Néant, que Dieu va
peut-être perdre, un peu par ma faute ; il faut l’aider. » Silence. Terrain
glissant. Le président tente maintenant de démontrer la misogynie du condamné,
lui reproche d’avoir dit qu’il avait connu des femmes possédées, d’autres
possédantes, mais que toutes étaient possessives (murmures de réprobation dans
la salle). Le condamné dérape : « Les femmes ont besoin d’un homme
pour se persuader qu’elles existent, pour jouir, mais d’elles-mêmes. » Il
s’enferre : « Les femmes se vengent sur l’homme d’avoir besoin de lui
pour exister. » Il se fait huer. Heureusement pour le condamné, un ancien
maoïste (avec ces individus-là on peut s’attendre à tout) vient à la barre dire
son admiration pour Morand. Il accumule les exemples tirés des livres du
condamné, tantôt descriptions de villes, de campagnes : « La bruyère
triangulaire, ombre sur le sol comme des livres, ciel bleu autour des feuilles
festonnées du chêne. Les troncs coupés à ras, avec rejets. » Le président
interrompt la séance lorsque le maoïste se lance dans une apologie du
libertinage dans l’œuvre du condamné. « Nous verrons cela une autre
fois », coupe-t-il sèchement. Là-dessus, le condamné veut exprimer un avis
énigmatique : « Si l’épicurisme est une foi, ses églises sont
naturellement baroques. » Le procès, ajourné, s’achève ainsi dans la confusion.
Paul Morand, Journal inutile, Gallimard, 2001.
Discours Parfait, pp.371-375, folio n°5344
Le corps de Morand
C. DOUZOU, F. BERQUIN : Pour ouvrir cet entretien, permettez-moi
tout d'abord de citer une phrase de La Guerre du Goût. Il est question de Beckett, et vous écrivez ceci : « on ne
s'intéresse pas assez au corps des écrivains : il a la même importance que
leurs livres ». Vous ajoutez, un peu plus loin : « il y a bien continuité de
tissu et de rythme entre les livres et la façon dont le corps qui les a écrits
marche, parle, se tait, apparaît, disparaît ». Vous dites encore, et vous le
dites comme ça, en passant, dans une émission télévisée consacrée à Paul
Morand, que cet écrivain a selon vous « un corps très intéressant ». J'aimerais
que vous nous disiez ce qui vous intéresse dans le corps de Morand. Que peut
nous apprendre le corps d'un écrivain, et plus précisément, que peut nous
apprendre le corps de Paul Morand ?
PHILIPPE SOLLERS : Alors, écoutez,
c'est très simple. Le corps des écrivains est très varié. On pourrait comparer
avec le corps des peintres, qui a une certaine unité dans la mesure où un
peintre à la limite ne vieillit jamais. C'est pratiquement dans son grand âge
qu'il peint parfois les tableaux les plus violents, les plus érotiques, les
plus révélateurs d'une sorte de jeunesse éternelle. Exemple : les dessins érotiques
de Rodin. Exemple : la vie de Picasso à partir de 1960, 70, et les derniers tableaux.
Exemple encore : Francis Bacon jusqu'à la fin. C'est un décor de grande
dépense, parfois de grande débauche, et il y a là en tout cas une puissance érotique
qui non seulement ne se dément pas mais s'aggrave au point que l'interprétation
en général sera négative, c'est-à-dire qu'on pensera qu'il s'agit
d'impuissance, de sénilité ou d'obsessions frustrées, ce qui a eu lieu
notamment pour Picasso après la Deuxième Guerre mondiale et surtout pour les
tableaux de la fin de sa vie. Pour les écrivains, c'est assez différent. Car il
n'y a pas cette même faculté de rajeunir en vieillissant avec ce geste qui
consiste à peindre dans la couleur ou à sculpter. Donc, les cas sont très
diversifiés. On peut avoir un corps tout à fait précoce : ça, ce sera Rimbaud.
Un corps souffrant, et ce sera Proust avec son asthme. Joyce avec ses histoires
d'yeux... Antonin Artaud avec une difficulté psychique que d'ailleurs il
analyse admirablement... Hemingway avec des problèmes d'alcoolisme... Faulkner
aussi... Ou encore Fitzgerald qui, lui, souffre d'abord d'être très beau, ce
qui est très mauvais pour un écrivain. Il vaut mieux qu'un écrivain soit
légèrement handicapé et assez ascétique ou, du moins, pas visiblement très beau
parce que autrement... Vous comprenez, on ne peut pas tout avoir : la beauté,
le talent, le génie et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire l'argent et les femmes,
alors, bon, ça suffit comme ça !
Or, dans le cas de Morand, la
beauté est évidente. Et, évidemment, il cumule tout ce qui peut être jugé comme
négatif : le sport, le cheval, les voitures, les femmes, le succès... Comment
voulez-vous qu'on lui pardonne tout ça ? En général, quand quelqu'un sent qu'on
ne pourra rien lui pardonner du tout à cause même de son existence physique, il
va s'engager dans des voies périlleuses qui accroîtront le préjugé, qui ne
feront que le rendre plus compact. C'est le cas par exemple de Céline, homme
fort beau au demeurant et fort dépensier de son énergie, qui a senti qu'il
était l'objet d'un ostracisme à cause même de son corps et que, par conséquent,
il lui fallait découvrir la cause de cette exclusion. Ça l'a amené en effet à trouver
quel était son ennemi principal de ce point de vue..., ce qui n'a fait
qu'accroître le préjugé à son sujet.
Les écrivains sont des gens à qui
on ne pardonne rien. Et ce n'est pas plus mal comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont
un corps qui est tellement branché sur le rythme, la verbalisation immédiate,
la sensation, la perception justes, y compris un érotisme très précis —
encore une fois très différencié, ça dépend des cas —, qu'on a
l'impression qu'ils vivent dans une sorte de paradis tout à fait réel, pas du
tout « artificiel » comme dirait Baudelaire (autre cas, sans parler des
autres). À partir du XIXe siècle, ça commence à être très violent
sur cette question de corps : il y a des corps reconstitués, il y a des corps
que vous emmènerez éventuellement au Panthéon mais enfin dans une comédie
spectaculaire qui ne devrait pas leurrer le spectateur mais qui le leurre quand
même parce qu'il est devenu de plus en plus passif.
Morand, donc, eh bien, écoutez :
il suffit de dire que Proust a dit de lui qu'il aurait aimé vivre sa vie,
c'est-à-dire, au lieu de rester confiné en train de faire évidemment un des
grands chefs-d'œuvre de la littérature française (on n'a rien sans rien,
peut-être), qu'il aurait aimé avoir la vie de Morand. Proust l'a dit. C'est
évident aussi dans la préface qu'il a écrite pour Tendres Stocks. Au fond, Proust se demandait comment on pouvait
être Morand.
Alors, bien entendu, Proust qui
était amoureux de Morand, c'est très clair, fait semblant de s'intéresser à la
princesse Soutzo mais enfin on connaît ce genre de
ruses qui consistent à ménager le décor alors qu'on est éperdument sensible à
ce jeune homme brillant qui commence très vite, qui a du succès et qui amène un
style absolument nouveau. Quel style nouveau ? Eh bien, Morand a aussi
l'hommage de Céline. Proust et Céline, c'est beaucoup dans une vie comme
éloges... Céline se considère évidemment comme le plus fort, ça va de soi, mais
enfin à part Morand, le fait de savoir rythmer, jazzer un peu la prose, d'être
là où il faut, eh bien, à part Morand, pour Céline, il n'y a personne.
Morand, pour moi, c'est évidemment
l'écrivain le meilleur après Proust et Céline, n'est-ce pas. C'est un peu
absurde de parler comme ça en termes de catalogue, mais enfin il vient là quand
même en troisième position pour le XXe siècle à cause précisément de
sa grande liberté... je dirais physique, qui, tout en le laissant dans une
moindre ambition, fait de lui indubitablement le meilleur écrivain français en
troisième position. Il suffit de l'entendre, de le voir, de l'entendre parler
pour voir avec quelle justesse il décrit par exemple la visite que lui fait
Proust, chez lui, un soir, etc.
Ce qui est frappant chez Morand,
c'est l'extrême économie des moyens, brusquement rythmique, qui correspond tout
à fait à la phase de l’après-Première Guerre mondiale, c'est-à-dire, en effet,
les nouvelles, le voyageur, le New York dont j'ai fait la préface pour une réédition, en insistant beaucoup sur le fait
que très peu d'écrivains à l'époque ont compris ce que pouvaient être les
États-Unis d'Amérique. Il fallait les voir en 1930... Donc, il y a Claudel
là-bas, mais enfin Claudel ne nous parle pas vraiment de ce qui est en train de
monter comme puissance énergétique. Il y a évidemment Céline dans Le Voyage au bout de la nuit, et puis le
corps des Américaines inaccessibles... Mais enfin, Morand est là de façon tout
à fait éblouissante, poétique... Morand, c'est un poète, c'est un poète d'abord, avec ce corps-là. Il y a des
poèmes excellents de Morand, très forts, très percutants, très intelligents.
Jean-Jacques Schuhl m'a beaucoup surpris récemment :
on était ensemble et, tout à coup, il m'a sorti un poème de Morand, « Brahma »,
je crois, un poème extraordinaire. Et puis, Morand, c'est aussi une prose
adaptée au temps, au temps de cette explosion historique et économique,
c'est-à-dire les années 1920 et 1930.
Quels
sont les livres de Morand qui, de ce point de vue, vous semblent les plus
marquants ?
Je mettrais en priorité les
nouvelles, Ouvert la nuit, Fermé la nuit,
bien sûr, mais surtout L'Europe galante que je trouve absolument excellent comme livre. L'idée que plusieurs femmes
pourraient faire d'un homme un portrait qui serait définitivement contrasté au
point qu'on ne saurait plus qui c'est — c'est « La glace à trois faces »
—, ça, j'aime bien. J'avais eu l'idée moi-même, autrefois, de faire comme
ça une sorte d'évangile à rebours, c'est-à-dire quelqu'un qui serait raconté
non pas par des disciples hommes, mais par des femmes, disons une douzaine...
comme les apôtres, et à ce moment-là, on finirait par ne plus savoir de qui il
s'agit tellement les versions seraient différentes : les unes seraient
absolument idylliques, d'autres seraient infernales, d'autres seraient purement
et simplement répulsives, d'autres seraient absolument adorantes,
etc. Donc, on arriverait à ne plus savoir de qui il s'agit vraiment, ce qui est
peut-être la position la plus révélatrice de ce que pourrait être un homme s'il
en existait un, vu que s'il en existait un — ce qui reste à prouver,
c'est d'ailleurs ça le fond de la question —, s'il en existait un, on ne
saurait pas finalement qui c'est. Donc, Morand a compris ça. Pourquoi ? Parce
que je pense qu'il a été en effet ce qu'on appelle un homme, ce qui est très
difficilement « trouvable » sauf à marcher dans les rues avec une bougie
allumée, comme Diogène autrefois... Alors, qu'est-ce qu'un homme ? Tout le
monde croit savoir de quoi il s'agit. Justement, les écrivains sont là pour
qu'on en doute et qu'on se demande de quoi il s'agit. Est-il bon ? est-il méchant ? est-il vraiment
humain ? Ce n'est pas sûr, parce que souvent ce qui devrait accompagner l'homme
tel que nous le décrit la marchandise bien-pensante, ça devrait être quelqu'un
qui n'aurait pas de contradictions, ou j'allais dire même plus modestement d'aventures, ou plus exactement encore,
qui n'aurait pas d'aventures qu'il pourrait raconter, parce qu'on peut
éventuellement avoir des aventures comme sportif, comme explorateur, comme
scientifique, mais avoir des aventures qu'on pourrait dire et raconter
personnellement et de façon détachée, ça, c'est encore plus rare. Donc, nous
avons plein d'hommes avant d'arriver au fait qu'il pourrait peut-être y en
avoir un qui serait muni d'un corps qui serait capable de dire à chaque
instant, ce qui est visiblement le cas de Morand.
Alors, en quoi est-il intéressant ?
C'est une énigme, il a fait semblant
de vivre dans la société convenable alors que, tout compte fait, il s'agit d'un
anarchiste... spiritualiste quand même, dans la mesure où, eh bien, il faut
lire son Journal pour s'en
apercevoir, il sent constamment la présence de Dieu dont il n'a pas besoin de
s'expliquer qu'il existe ou pas. Donc, ça va beaucoup plus loin que toutes les
fariboles d'ambassades et de mariages, de voyages et de représentations
sociales et de réceptions et d'Automobile-Club et de cheval, etc., sur
lesquelles l'opinion se jette pour éviter de le lire.
J'ai énormément aimé le Journal inutile qui, évidemment, a
provoqué beaucoup de levées de boucliers, de réflexes pavloviens, et j'étais
très, très étonné que ce vieillard, jusqu'en 1976, soit aussi lucide, flexible,
voyageur, courageux, maître de lui et de sa lucidité et aussi tellement
touchant dans le rapport qu'il a avec sa femme dont on voit bien qu'il
accompagne la mort d'une façon à la fois sublime et détachée. Ça m'a beaucoup
frappé.
À ce sujet, je voudrais signaler
qu'au fond, ce Morand, sur le plan métaphysique, ne croit visiblement à rien
d'autre qu'à sa présence là, dans l'espace, avec le corps qu'il a, les aventures
qu'il a eues, il ne croit qu'au moment qui peut se passer d'un bout à l'autre
de la planète. Mais, ce qui est très frappant, c'est qu'au fond la religion de
sa femme — qui a eu par rapport à la question de l'antisémitisme des
positions fanatiques, on le sait —, c'est la religion orthodoxe. Ce qui
fait que le livre tant vanté de Morand qui s'appelle Venises, souffre à mon avis
— encore que ce soit un magnifique livre — de cette perspective,
qui lui fait complètement méconnaître la catholicité de Venise. Il est sensible
au côté orthodoxe, byzantin, de Venise, mais alors il ne voit pas le reste. Et
Proust non plus d'ailleurs. C'est très étrange ça, parce qu'à ce moment-là, on
peut se demander si quelqu'un arrive à voir vraiment Venise, comme ce que
Venise est. De ce point de vue, les erreurs au cours des âges sont assez
étranges... « Que c'est triste Venise »... « La mort à Venise »... Heidegger
passe sans rien voir, il croit que c'est une ville pour les touristes. Proust
ne voit absolument rien d'autre que finalement des choses très, très convenues
et Morand ignore superbement Palladio, le reste, c'est-à-dire vraiment... quoi ?...
la grande célébration de la Contre-Réforme à Venise.
Ça va si loin — c'est de
l'amour mais de l'amour à mort si je puis dire — que Morand se fait « cendrifier » avec son épouse dans le même tombeau... sous
l'égide de l'Église orthodoxe, ce qui est surprenant, mais qui s'explique
lorsqu'on lit Hécate et ses chiens et
qu'on voit à quel point il se décrit lui-même à travers son aventure. Il se
décrit comme étant originaire d'une France un peu protestante alors qu'on sait
que ses origines sont d'un radical-socialiste au fond, c'est-à-dire qu'il a
d'abord vécu dans un contexte d'assez grande ignorance religieuse. Ça rend sa
position d'autant plus intéressante.
Hécate et ses chiens est un livre magnifique. D'abord, Hécate,
c'est une déesse... Et puis, là, on voit très bien à quel point Morand, tout en
se risquant sur la question sexuelle, a l'air de porter une sorte de regard
noir, c'est le cas de le dire, sur cette question. Il n'est pas très à l'aise
avec ça. Hécate et ses chiens, c'est
l'histoire d'une femme qu'on devrait appeler « pédophile », mais alors appelons ça « pédophèle ». La « pédophélie » est assez rare pour que ce roman se présente
sous une forme de symptôme très important. Le narrateur est quand même conduit
à suivre une sorte de manie ou de nymphomanie ou de possession « diabolique »
qui fait que, de même qu'un autre type qu'il rencontrera plus tard, il reste là
transi devant le mystère que serait en effet cette chasse de la déesse à
travers les corps qui ne sont pas vraiment désignés comme tels, mais qui sont
quand même disons pubères.
La question sexuelle est
intéressante sur tout le XXe siècle, c'est-à-dire qu'il faut
toujours se demander, à propos de corps, comment les écrivains ont traité la
question sexuelle. Moi, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Parce que,
là, j'ai remarqué un certain nombre de points qui me paraissent essentiels dans
le rapport du corps au plaisir ou à la jouissance, à la sexualité... À la « sessualité », comme dirait Queneau, parce qu'il ne faut pas
non plus en faire un plat (on a fait trop de plats)... Mais enfin, c'est
intéressant, dans tous les cas : voir comment le corps en question, à la
différence de celui des peintres — qui sont souvent beaucoup plus à
l'aise avec les modèles, avec les situations, je n'insiste pas, Picasso peut
vous dire... — avec les écrivains, donc, il y a souvent des problèmes,
enfin, des embarras... Nous sommes loin du XVIIIe siècle et Casanova
serait très étonné de voir qu'au XIXe siècle il y avait vraiment
comme qui dirait quelque chose qui ne marchait plus très bien entre les sexes
ou alors qu'il y avait des embarras ou, disons, des localisations bizarres. Je
cite Gide : vous avez compris ce que je veux dire. Lisez Le Ramier qui vient de paraître chez Gallimard où on voit des
notables de la IIIe République faire roucouler un jeune garçon.
Évidemment, la seule question qui n'est pas posée, c'est le rapport social, le
rapport de classe.
Une
question que pose Morand est celle, tout à fait obsédante, de ce que peut
représenter l'homosexualité.
L'homosexualité, mais aussi la
judaïté. Il est en effet bien évident que Morand y revient sans cesse. À la
limite, c'est trop. Il est tout le temps sur la défensive par rapport à ça,
mais être sur la défensive, ce n'est pas la peine parce que ça voudrait dire
qu'on se défend de quelque chose qu'on aurait en soi et à quoi on ne pourrait
pas souscrire. Si l'on n'est pas du tout tenté par l'être juif ou par l'être
homosexuel, il n'y a pas lieu de s'en défendre. Puisque, de toute façon, la
question ne se posera pas. C'est vrai aussi chez Céline bien sûr, à part
quelques moments tout à fait très beaux. Il faut lire
ses lettres à ses correspondantes, quelques passages aussi que vous avez dans Voyage au bout de la nuit : c'est Molly, par exemple, à Détroit, ou bien Sophie, dans
l'asile, l'hôpital psychiatrique où il travaille. Mais enfin, là encore, il y a
une idéalisation, une amplification du corps féminin comme danseuse, etc. On
connaît très bien le disque magnifique de Céline à ce sujet : c'est les jambes,
ceci, cela... Voyez la correspondance avec Nimier : ils s'envoyaient des photos
de femmes pour donner des notes... Tout cela est bizarre. Le XIXe et
le XXe, là, sont très étranges, il faut bien le dire. Comme je suis
dix-huitiémiste fondamental, je lis tout ça de façon
intéressée, certes, mais un peu clinique quand même, voilà !
Morand, d'ailleurs, dans ce
contexte, ne s'en tire pas du tout mal. Il y a quand même reconduction d'une
sorte de matriarcat fondamental, dans l'existence, et ça, c'est touchant mais
en même temps nous laisse perplexes. Vous allez me dire que c'étaient des époques
avec peu de liberté mais rien ne prouve que nous soyons plus libres aujourd'hui
malgré les prédications sur l'épanouissement sexuel qui sont d'ailleurs controuvées
par l'expérience. Il y a un problème historique dont témoignent au mieux ces
écrivains-là. Alors, ne parlons pas du reste.
Continuons,
si vous le voulez bien, à parler du corps de Morand. Pensez-vous que les
photographies assez nombreuses qui nous montrent Paul Morand (Morand au volant
de sa Bugatti, Morand en scaphandrier, en Charlus, en
nageur, en cavalier, en skieur, en académicien, etc.), pensez-vous que ces
photographies peuvent nous permettre de mieux connaître le corps de cet
écrivain ?
Oh, les photos, vous savez, ça
fait partie de l'imagerie. Moi, il me suffit de deux ou trois photos... Je
crois que les écrivains, il faut d'abord les lire. Cela dit, on voit très bien,
en regardant ces photographies, quelle est sa facilité : 1. à se mouvoir, 2. à
s'émouvoir, 3. à rencontrer des personnages très différents les uns des autres,
des femmes très différentes les unes des autres. Mais il y a aussi autre chose.
Il y a comme qui dirait un recul. Et
cela qui est très fin, très intelligent, demanderait à ce qu'on pose un
diagnostic plus profond. Je ne vais pas faire arriver Freud, mais enfin quand
même on pourrait le faire un peu.
Il l'a dit lui-même : surtout pas
de pornographie, pas de journalisme. Nous sommes d'accord là-dessus, mais c'est
vite dit. Aller plus loin dans l'analyse n'est pas forcément de la pornographie
et quant au souci de déchiffrer l'envers de l'histoire, ça n'est pas forcément
non plus du journalisme. C'est drôle, cette formule... Comme si le journalisme
était pornographique ou la pornographie était du journalisme... Il faut retenir
le fait qu'il y a chez Morand une sorte de pudeur. Oui, c'est cela. Morand
pudique... Avec des pointes extrêmement aiguës sur les questions essentielles.
Mais beaucoup plus pudique que Proust par exemple. Il faudrait d'ailleurs
admettre qu'au XXe siècle (déjà loin de nous), les formes les plus
impudiques auraient été plutôt homosexuelles. Je pense par exemple à Proust ou
à Genet. Alors que, de l'autre côté, il y aurait eu, comme qui dirait, un
problème. C'est une des questions qu'on peut poser à propos de Morand parce
qu'il signale bien ce qu'aurait été l'« Europe galante », avant qu'elle ne
sombre dans l'absence totale de galanterie, c'est le moins qu'on puisse dire...
La sexualité,
chez Morand, quoi qu'on ait dit à ce sujet, ne semble jamais très heureuse.
Éros apparaît souvent malade, vaguement infernal (mais aussi parfois très
comique...).
C'est très ambigu, cela. Il y a
bien cette nouvelle admirable, « Céleste Julie », la fille au téléphone...
C'est une nouvelle magnifique de précision, et là, il frôle le « diabolique ».
Il n'y a pas en effet tellement de raisons d'assassiner quelqu'un au téléphone
pour que — c'est très habilement amené — pour qu'une fille se
branle — il n'y a pas d'autre mot — dans un grand spasme
hystérique. Mais, vous savez, la sexualité comme enfer, comme chose principale
de la question de l'existence, cela me paraît très daté.
N'y
a-t-il pas quand même une discordance entre l'éloge de ce que vous appelez la
liberté physique et cette valorisation de l'ascèse qu'on trouve dans maints
textes de Paul Morand?
Oui, mais beaucoup moins quand
même que chez quelqu'un de très bizarre comme Montherlant qui, après
l'extraordinaire réussite des Jeunes
Filles, va traîner sur les boulevards à la recherche de jeunes garçons...
Chez Morand, ce n'est pas tellement discordant. Morand, c'est quelqu'un qui
veut se maintenir en forme à tout prix. Tout simplement pour avoir sa liberté
de mouvement. Sa liberté de mouvement, pourquoi ? Tout simplement pour voyager,
même en « voyageur (presque) organisé ». C'est-à-dire qu'il s'installe de façon
maîtrisée avec son corps. Il vit son corps comme un cavalier vit son cheval. Il
est monté sur lui-même, et il faut tenir le coup. Pourquoi ? Pour bouger, pour
se « planétariser » sans cesse. Voilà, il tourne. Il
revient bien sûr à Paris dans son bel hôtel particulier, où il y a des dîners
qu'il décrit à la Proust, de façon très sarcastique. L'Académie ? Bon, allez
voir si j'y suis...
Ce que je comprends, c'est qu'il
veut se maintenir en bonne forme jusqu'au bout. Pas pour le faire croire. Pour
l'être réellement. En tant que la vie est un sport qui se termine par la
disparition. D'où, la maîtrise de soi dans la vitesse, l'équilibre, la façon de
respirer. C'est très frappant chez lui.
Il
y a quand même une vraie violence dans ce « dressage » du corps...
La violence vient de la pudeur. La
pudeur de Morand me paraît essentielle. Et pourtant, ce qu'il y a de plus
extraordinaire dans le Journal inutile,
c'est la façon dont il vérifie ses actes de dépense de sperme jusqu'à la fin.
Il y a là un regard médical extrêmement étonnant. Rare. Très rare. Les éjaculations
de Morand... Il faut insister là-dessus, car vous n'avez ça chez aucun autre
écrivain à ma connaissance. Sauf peut-être chez Casanova ou chez Sade, bien
sûr. Mais ne convoquons pas celui-là ! C'est très, très rare qu'il y ait un
regard sur soi à propos des fonctions physiologiques. Gide est incroyablement
flou de ce point de vue. Morand est très précis. Et avec, évidemment, un regard
aussi sur la substance féminine qui est très décapant. Moi, je trouve ça très
bien, mais ça choque beaucoup, bien sûr. Le clitoris qu'on n'arrive pas à
situer exactement... Il y a là des notations d'une extrême précision, qui vont
beaucoup plus loin que ce qu'on lit ordinairement, même chez les meilleurs.
Cela
ressemble parfois beaucoup à un discours misogyne...
Le fait d'être précis serait
misogyne ? On pourrait accuser le jardinier d'être précis, on ne peut pas lui
reprocher d'être hostile à la Nature...
Misogyne ou non, c'est un fait que Morand plaisait.
Je crois en effet que Morand
plaisait, qu'il était charmant, qu'il n'avait pas beaucoup d'efforts à faire
pour séduire. C'est souvent très beau, la façon dont il emballe tout cela. Vous
savez, la beauté physique n'est pas obligatoire : Sartre plaisait beaucoup aux
femmes et pourtant il n'était pas extraordinairement présentable... Qu'est-ce
qui plaît aux femmes ? Au point qu'elles acceptent d'être plusieurs dans une
vie d'homme, qu'elles souffrent peut-être mais qu'elles se rendent à l'évidence...
Qu'est-ce qui irradie dans la capacité de Morand à séduire ? Je crois que, tout
simplement, c'est dû à sa lucidité sur ce plan. Un homme qui se révèle être,
avec les mots, particulièrement avec les mots — sinon, on ne sait plus
très bien de quoi on parle ! il faut que ça se dise !
—, qui se révèle être très lucide sur ce genre de questions est presque
automatiquement l'objet de demandes féminines. Il ne faut évidemment pas tomber
dans le cliché qui dirait qu'un tel homme est misogyne. Ça n'a rien à voir.
D'ailleurs, ce sont les femmes qui sont misogynes la plupart du temps. Si elles
ne l'étaient pas, ça se saurait ! Non, il est clair que le fait de se présenter
comme froid ou détaché ou expert dans ce domaine avec des mots facilite
considérablement les choses du point de vue du désir féminin. Je viens de
travailler sur Fitzgerald, un peu. Il a cette réflexion extraordinaire dans ses Carnets qui sont très beaux, il était
très beau lui-même (ce n'est pas sans rapport, Morand et Fitzgerald). Donc, Fitzgerald
dit : « Je n'avais pas les deux trucs supérieurs, c'est-à-dire le grand
magnétisme animal et l'argent mais j'avais les deux trucs juste au-dessous qui
sont la beauté et l'intelligence. Et c'est pour cela que j'ai toujours eu la
meilleure fille. » C'est très joliment dit. On peut dire que Morand avait la
beauté et l'intelligence, un certain magnétisme animal avec son cheval —
puisqu'il se présente en cavalier, hein ! — et... l'argent. Donc, ça fait
beaucoup. Et, en plus, il écrit très bien. Parce qu'on pourrait très bien avoir
un certain magnétisme animal, l'argent, la beauté, ça devient déjà très
rare..., mais en plus, en plus, et c'est peut-être ça le fond de la question,
c'est un grand écrivain.
Avec des qualités que l'on connaît
: rapidité, fulgurance, oui, bien sûr.
À
ce propos, avez-vous l'impression, comme d'autres lecteurs, que le style de
Morand ait évolué ? Plus précisément, peut-on dire qu'il y a chez Morand, comme
on le dit parfois des peintres, des « manières » différentes ?
Non, pas du tout. Ça, ça n'existe
pas. Un artiste reste absolument constant. Même Picasso, n'est-ce pas. J'ai été
très sensible à cela dans l'exposition Picasso
érotique... C'est le social qui décide de diviser une œuvre en périodes,
souvent d'ailleurs à cause de problèmes politiques ou de problèmes de
classification. Les Américains ne pouvaient pas supporter que Picasso ait
survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ont décidé que tout ce qu'il
faisait à partir de là était sénile et sans importance. Évidemment, c'était une
grosse erreur, car ça renvoie exactement à ce qu'il faisait au début. Et
Morand, d'emblée, c'est Morand. On sent très bien qu'il a tout de suite une
phrase et des aimantations très précises... Ça peut se prouver.
On voit très bien aussi les
auteurs qu'il adore dans le Journal
inutile : c'est Saint-Simon par exemple. Vous dites Saint-Simon : vous
comprenez exactement tout. C'était déjà l'idéal pour Proust, qui a changé ça en
circonvolutions admirables...
Morand, si vous voulez, c'est un
écrivain de la fin du XVIIe, XVIIIe, un écrivain du
Royaume, égaré non pas dans le monde moderne (Morand est parfaitement à l'aise
avec la technique : les bagnoles, les bateaux, les avions, etc.), pas dans le
monde moderne, donc, mais égaré dans la culture de masse. Cavalier de plus en
plus solitaire, de plus en plus détaché de la culture de masse. Aristocratique,
par définition.
Déplus
en plus solitaire... De plus en plus silencieux, aussi. Et puisqu'il s'agit
d'un entretien, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre pourquoi un homme
comme Morand a toujours éprouvé à l'égard précisément de l'entretien ou du
dialogue, une gêne, et même une sorte de peur. Tout se passe même souvent, dans
son œuvre, comme s'il y avait quelque chose d'obscène et d'assez épouvantable
dans le simple fait d'ouvrir la bouche. Il va d'ailleurs jusqu'à affirmer, à
plusieurs reprises, qu'il écrit parce qu'il ne sait pas parler...
Pudeur, là encore... Mais
remarquez qu'à chaque fois qu'il donne un entretien, c'est prodigieux. Boutang place sa caméra et c'est tout de suite épatant à
partir du moment où Morand raconte... Morand est un raconteur admirable...
Donc, tout simplement, ça l'embêtait, oui, voilà, mais Morand parlait très
bien. Céline aurait pu faire des dizaines et des dizaines d'entretiens
admirables, on n'en a qu'un d'enregistré. Mais bon, on entend la voix. Et c'est
immédiatement parfait. Vous imaginez dix heures d'entretien avec Proust avec
quelqu'un qui l'aurait poussé un peu... Ça aurait été fabuleux... Non, ce qui
embête Morand, c'est de parler pour ne rien dire. Au fond, dans les « déjeuners
», il n'a rien à dire, et ça l'ennuie. Et puis, il faut avouer que souvent le
fait de parler oblige à baisser son niveau. Et il faut bien dire aussi que
souvent, on tombe sur des crétins. Voilà, c'est la position aristocratique...
Mais il faut dire encore que l'exil, la méfiance, le fait de se sentir épié, le
fait que le moindre mot pourrait être immédiatement employé pour ceci ou
cela..., et puis l'histoire avec l'Académie, qui tarde..., et la revanche, et
Vichy, tout ça, patati, patata, bon, ça dure quand même assez longtemps pour
que ça transforme un caractère. Les grands traumatismes d'exil ou d'enfermement
sont souvent irréversibles. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu
beaucoup de drames précis. Morand a échappé à tout ça, mais la Suisse, ça peut
quand même user ou rendre très méfiant le système nerveux même le mieux
maîtrisé. Quelqu'un qui s'en est sorti par un silence absolu, alors, ça, c'est
Ezra Pound que je voyais souvent à Venise sous mes fenêtres : il ne parlait
plus du tout, il observait ses mains. Il s'était tu. Il était entré dans le
grand silence. Il y avait aussi une sorte de silence chez Morand, mais que je
crois davantage induit d'abord par sa pudeur et ensuite par le contexte
sociologique exécrable dans lequel il s'est trouvé du fait de l'Histoire
(puisqu'il est parti sur le très mauvais côté de l'Histoire).
Il est vrai d'ailleurs qu'il est
resté étrangement silencieux sur la question politique. Sur les soubassements,
sur les basculements... Pourquoi Morand n'est-il pas resté à Londres ? Pourquoi
Céline et Morand ne sont-ils pas restés à Londres ? Il y a pourtant des choses
merveilleuses de Céline sur Londres. Ils n'ont pas compris qu'il fallait rester
à Londres un certain temps, tout simplement. Et pourtant, c'est beau, Londres,
c'est une ville que j'aime beaucoup... Il y a de grands parcs... On peut
facilement y rester quatre ou cinq ans... Mais enfin, c'est comme ça. Peut-être
encore une fois trop conjugal, Morand, de ce point de
vue... Et puis, il y a les questions d'argent aussi. Voilà, il faut analyser
tout cela assez rapidement.
Simplement, pour en revenir à
votre question, il y a une chose qui me frappe chez lui, c'est la modestie tout
de même. J'ai souvent rencontré des grands écrivains assez modestes. Morand est
modeste. Son Journal se dit « inutile
»... Après tout, tout ce que j'ai écrit... Proust n'était sûrement pas modeste !
Mais quelqu'un qui l'était par exemple, c'est Mauriac qui pensait qu'après
tout, à côté de Proust, ce n'était pas grand-chose, ce qu'il avait fait... Et
Proust lui-même, au fond, aurait pu penser qu'après tout, oui..., tout ça...
Kafka aussi était très modeste : vous n'avez qu'à tout brûler... Voilà : il y a
un point où ça n'a plus d'importance.
Que
dire après cela ? J'aimerais quand même en revenir à la question du corps. Le
corps qui est peut-être l'unique modèle de Morand. Je m'étonne à cet égard qu'il
y ait tant de personnages désincarnés dans son œuvre. Des personnages
essentiellement disparaissants. Je songe à « Monsieur
Zéro », ou au «Locataire», monsieur Grosblanc, ou
encore à tous ces personnages insaisissables que sont par exemple « l'homme
pressé » ou le taciturne Lahire.
C'est moins bon. Il y a des livres
assez décevants de Morand. J'ai relu L'Homme
pressé, ce n'est pas très bon. Il y a quelques livres extrêmes, il y a
aussi des longueurs. Il n'écrit pas que de magnifiques choses... À propos de
Proust, je serais bien embêté de vous dire : je préfère Du côté de chez Swann à Sodome et Gomorrhe... C'est l'Œuvre. Morand, lui, n'est pas l'obsédé d'une
œuvre. Vous savez, deux, trois bons livres, quatre... : Ouvert la nuit, Fermé la nuit, L'Europe galante, Hécate et ses chiens.
Les « portraits de ville » aussi sont très beaux, très impressionnants. La
poésie aussi... Mais qui lit cela?
On
en parle, en tout cas...
On parle beaucoup des écrivains
sans les avoir lus, des peintres sans les avoir vus, des musiciens sans les
avoir entendus... On parle de la mythologie des écrivains selon la perspective
du comité central, on ne parle plus des écrivains, de ce qu'ils écrivent. Moi,
j'ai l'habitude, et peu m'importe ! C'est le Spectacle ! Une fois qu'il y a
cinq ou six bons clichés, on les répète. La propagande s'en charge. Pourquoi
voulez-vous faire un effort, lire des phrases ? Il ne faudrait pas faire
semblant que les gens lisent, ils ne lisent pas. C'est la question
d'aujourd'hui. Ça n'était pas une question des années 1920 ou 1930. Céline se
rend compte de cela petit à petit. C'est le plus percutant sur la question.
Voyez les Entretiens avec le professeur Y...
C'est un chef-d'œuvre, on est par terre de rire à chaque instant. Et c'est tout
à fait dans le cœur du sujet. Morand, non, il s'en fout, il appartient à une
histoire, à une certaine classe sociale en cours de liquidation, et d'ailleurs
il finit dans une sorte de désespoir. Il s'en fout parce que son monde a disparu.
Il pense que la société civilisée européenne a disparu, ce qui n'est pas faux,
mais ce qui n'est pas forcément apocalyptique. La question qu'il faut poser est
plus essentielle. Il faudrait se dire que se lire soi-même peut suffire à ce
que ça existe. A-t-on vraiment besoin d'être lu?
C'est vers le lecteur inconnu de l'an 2000 que Morand se tourne à la
fin...
Ce qui est à la fois très élégant
et très pessimiste. À juste titre, d'ailleurs, si on croit à un destin
collectif. Mais enfin, pourquoi ? Il n'y a peut-être pas de destin collectif.
Bien sûr, on n'est pas sans péril ambassadeur, membre de l'Académie française,
on ne se marie pas impunément, on ne vit pas impunément dans le respect de
certains rites sociaux... Si ce monde-là disparaît, on risque d'être emporté
avec lui... Mais, dans le cas de Morand, c'est beaucoup trop percutant et
intelligent pour être passé par profits et pertes dans les poubelles d'une
classe sociale disparue. C'est pour ça d'ailleurs que Saint-Simon revient.
Saint-Simon aurait pu être lui aussi emporté dans le balayage de la monarchie.
Mais non, il y a quelque chose qui transcende électriquement les siècles. Et
que Morand, pour l'instant, soit plus ou moins à l'index, au fond importe
peu... Vous savez, il y a des auteurs qui sont restés à l'index, longtemps...
Sade est resté très longtemps à l'index. Je crois que ce n'est pas grave, ça.
Le problème est de savoir si ça tient le coup formellement ou pas... Si ça
tient le coup formellement, c'est là pour toujours. De ce point de vue, Morand
est déjà absolument classique. Pas de problème. Il me conforte dans ce que je
pense depuis longtemps, c'est que les modernes sont déjà des classiques. Il
suffit d'avoir le temps de s'en apercevoir. Les faux modernes ne sont jamais
classiques et les faux classiques ne rejoignent jamais le moderne. Les vrais
classiques sont modernes et les vrais modernes sont classiques, déjà.
Tenez, j'ai oublié tout à l'heure
de citer un livre magnifique, c'est le Fouquet
ou le Soleil offusqué. C'est un chef-d'œuvre. On ne peut pas faire plus
Vaux-le-Vicomte ! C'est très fort, très beau, très « autobiographique
dissimulé ». J'y ai beaucoup pensé en écrivant sur Denon, sur Casanova ou sur
Mozart. J'ai pensé souvent à ce petit livre qui est admirable.
Vous
pensez beaucoup à Morand en écrivant ? Avez-vous l'impression qu'il vous a influencé
?
Non, je ne crois pas, mais enfin,
j'ouvre un livre..., et hop ! On ne peut pas toucher à un art sans que tout le
monde ne se mette à vous rendre visite. Les morts vous parlent, n'est-ce pas...
Vous savez qui m'a influencé ? Tout le monde m'a influencé. La marquise de
Sévigné m'a beaucoup influencé. La Fontaine, ô combien ! Chateaubriand, je ne
vous en parle pas. Saint-Simon, tous les jours. Voltaire, à n'en plus finir...
Je viens d'écrire sur Jean-Jacques Rousseau, c'est admirable, c'est comme si
c'était moi qui avais écrit certains passages... Il n'y a pas de raisons de
s'arrêter. Baudelaire, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a pu
m'influencer. Rimbaud, c'est toutes les nuits, vers trois heures du matin. Le
français est quelque chose qui, en tant que langue, a eu une vie tellement
mouvementée, tellement étrange, tellement superbe, qu'il n'y a que les Français
qui ne sont pas au courant, qui ne sont plus au courant, qui ne l'ont peut-être
jamais été d'ailleurs.
Et c'est ainsi qu'on amène par
exemple Alexandre Dumas au Panthéon (c'est bizarre, cette façon de sortir des
cercueils, de les remettre en circulation, ce trafic de cercueils...). Oh là là ! Dumas ! J'adore Dumas ! Eh bien, vous aviez des
acteurs déguisés en mousquetaires et, derrière les chevaux, les types qui
ramassaient le crottin étaient quand même noirs. Quand il n'y aura que des
Noirs à cheval déguisés en mousquetaires et que, derrière les chevaux, on verra
des Blancs ramasser le crottin, je dirai qu'enfin la République est arrivée!
Enfin, on peut rire ainsi indéfiniment...
Philippe Sollers
Propos recueillis le 9 décembre 2002
par C. Douzou et F. Berquin
Discours Parfait, pp.383-404, Folio n°5344
|