|
Philippe Muray sur Paradis de Philippe Sollers
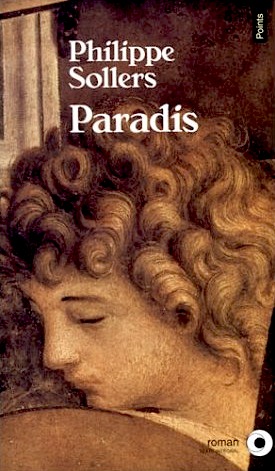
Regardez l’enchevêtrement des centaines de
milliers de circuits d’un microprocesseur sur sa tranche de silicium. La
planète en se planétarisant est devenue si
étrangement minuscule dans son gigantisme dévoilé qu’on peut d’ores et déjà
envisager de la traiter toute entière dans des systèmes électroniques à
capacité d’intégration d’autant plus grande que leur surface sera petite.
Regardez aussi très loin en arrière de nous ces
dallages d’église médiévales où étaient dessinés des
parcours de labyrinthes figurant la Terre Sainte, et plus mystérieusement les
chemins entremêlés du Paradis.
Mettez face à face avec leurs siècles de
distance ces deux représentations de la complexité absolue : d’un côté le
micmac transistorisé des données du monde réduit à ses abréviations, de l’autre
l’inextricable entrelacs des routes qui s’égarent et mènent à l’illimité.
Imaginez ce dialogue de dédales, la confrontation entre le miniaturisateur logique des données chiffrées du monde en chute, et le dessin de l’énigme dont
la question comme la réponse se trouvent hors de ce monde. Vous aurez un peu du
sens qui fulgure dans Paradis, un livre qui se dresse seul, tout
seul, comme une butte-témoin dans un espace dévasté. Un roman qui paraît aujourd’hui,
au milieu de la débandade accélérée de la littérature - retour en force des
archaïsmes, nouveaux terrorismes commerciaux, nouvelles répressions de la
langue, sinistres pressions de la "lisibilité" -, un roman dont
on ne peut sans émotion aborder l’incontestable grandeur.
Puisqu’il paraît que tout le monde veut du
vrai, de l’humain, du réaliste, disons les choses nettement : Paradis est
actuellement le compte-rendu le plus réaliste, le plus rigoureux, le plus
rationnel de nos comédies humaines versées à l’ordinateur. Pas pour y être
rapetissées, tassées dans la rigolade subjective d’une langue prétendue
naturelle (comme le fait notre nouvelle réaction classiciste, notre nouvelle
"école romane") ni pour y être stockées dans une encyclopédie devenue
folle (rêve des vieilles avant-gardes). Mais pour y être interprétées point par
point afin de dégager le sens de chacune de nos catastrophes.
Ni encyclopédie ni traité ni confession, ce roman est une Somme, le résumé
chiffré dans une lumière de révélation de ces débris d’histoire, de ces déchets
de bibliothèque calcinée que nous sommes. Avec un rire en plus, permanent. Mais
qui sait si les inventeurs de Sommes ne savaient pas rire ? L’humour
de Paradis veut dire : une complicité parfaite avec
chaque sujet traité, une intimité secrète avec chaque énoncé. Ça veut
dire : mon rire était là, sans moi, à chaque instant évoqué, au XIVe
siècle avant J.-C. comme au Ve après, à la mort de Shakespeare, à celle de
Freud, dans la familiarité et l’amitié de chaque évènement du monde, dans sa
compréhension la plus aiguë. On pourrait démontrer que la quaestio , une unité de mesure des Sommes
de jadis, y est mise en jeu sans cesse avec ces quatre temps logiques :
objections des adversaires, autorité sur laquelle s’appuie la réponse aux
objections, réponse, reprise des objections pour les réfuter. Le plan des
Sommes théologiques n’était autre que le plan de la réalité en train de se
communiquer à elle-même par ses créatures la perfection du Créateur. D’où vient
que le plan de Paradis soit quelque peu embrouillé, ou même
qu’une apparence de non-plan y soit délibéré ? Peut-être fallait-il ce
non-plan pour démontrer le plan maléfique à l’oeuvre dans la réalité, ce sans-plan pour éclairer le semblant de l’imbroglio
contemporain, cette distance pour le démêler de loin ?
Tout est clair dans Paradis, il
suffit de suivre chaque piste, chaque ressaut de l’énoncé annonçant une
nouvelle position de sujet, une nouvelle énonciation, inépuisablement.
Déplacez-vous par exemple dans un des couloirs sombres où Philippe Sollers
promène en les exorcisant les fétiches de ce temps, femmes, profs,
conférenciers, artistes, clients des divans, écoutez l’écho du « yapadom », « yorajamédom »,
qui résonne sur leur meute, revient de séquence en séquence, se ramifie de rime
en rime. De quoi cette ritournelle est-elle le refrain ? D’une absence fondamentale autour de laquelle tournent des rondes
orphelines d’autant plus enragées qu’elles ont voulu cette absence. Plus de
Père ! C’est-à-dire, pour la tribu, une dette d’autant plus envahissante
qu’impayable. D’où le cirque, la parade, la course en sacs de couchage des
hommes et des femmes, leur kermesse féroce à couteaux tirés, leurs emboîtement,
corps, sexes, fractions broyées d’artifices que Sollers entraîne, immerge dans
des flashes intarissables d’humour : « a couche avec b qui
couche avec c qui vient de coucher avec d qui va sans doute coucher avec e qui
regrette de ne plus coucher avec f qui recouche maintenant avec g qui ne veut
plus coucher avec h qui couche encore avec i qui couche avec la femme de j qui
couche avec la régulière de k qui couche moins souvent avec l qui couche avec
le mari de m qui couche avec le mec de n qui couche avec o p q r s non tu n’y
penses pas t est homosexuel comme u et v d’ailleurs w je ne sais pas mais x y z
sûrement le problème à présent c’est z va-t-il coucher avec a ». Il y a un
ordre à ce monde de possédés, c’est la « spermogrammation »,
et une réponse à tout : na . La réponse du Tout aux questions de tous : Na : « le dernier mot fond des choses la formule des
métempsychoses ». Il n’ y a pas de ponctuation dans ce livre pour faire
sentir à quel point cet univers est diaboliquement surponctué par le na des créatures en train de se
justifier ponctuellement sans cesse par leur procréation. Il n’y a pas de
ponctuation parce que les points et les virgules sont abondamment fournis par
l’enchaînement infini des générations dont la forme de ce livre est comme la
sculpture négative, révulsive.
Suivez aussi la grande déchirure du sujet
autobiographique : des prénoms de femmes, beaucoup de prénoms pris dans la
« danse hébétée ratée » du mirage sexuel, l’Histoire, Front
Populaire, guerre d’Espagne, Occupation, Bordeaux, Algérie, des maladies, des
crises, une morgue, une fin d’après-midi à Barcelone avec Dominguin offrant un taureau à la foule, une danseuse de cabaret, des voyages, New York,
le passage au crible quotidien des noms du passé et du présent, la culture,
toute la culture, tous les livres secoués chaque matin pour les faire avouer,
et aussi beaucoup de mouettes sur des rivages d’Atlantique, des rives de
départs, de décentrements. C’est le réalisme lui-même : les concrétions du
concret. Les phénomènes passent, Sollers nomme les lois qui font passer les
phénomènes. Le réel, disait Baudelaire, c’est « ce qui n’est complètement
vrai que dans un autre monde . »
De cet autre monde, quelle figure ont les choses d’ici ? Déchets, erreurs,
bals nocturnes dans des sépulcres... Ici ? Ici, la vie ne veut pas mourir,
c’est la mort qui vit. Les vivants n’ont jamais été aussi malades
qu’aujourd’hui parce que jamais ils n’ont si férocement refusé de mourir,
jamais si tragiquement désespéré de la mort. Ce qui fait que la mort - l’ordre
du monde, la jouissance du "diable" - est là, en nous comme dans les
Etats, aveuglée sur elle-même.
Pour le montrer avec tant de précision, il faut être déjà dans un "autre
monde" et que cet autre monde soit comme un rétroviseur lumineux sur ce monde-ci, braqué sur le blocage de toutes choses. Pourquoi
l’apocalypse serait-elle un point de dénouement après lequel il n’y aurait plus
d’après ? Pourquoi serait-elle une date ? Au contraire, tout indique
que le fini ne fait aujourd’hui que
commencer : « voilà tout a sombré il ne reste plus que les
documents monuments archives c’était avant-hier même perspective
après-demain ». La société du fini est éminemment différente de toutes les
autres en ce sens qu’elle n’a plus aucune raison de se terminer. La littérature
depuis toujours se préparait à cet avènement, maintenant c’est là « même
si l’abattoir a été lavé on a vu la peau du charnier ». Origène soutenait
que Dieu continue à créer constamment sa création qui n’a jamais eu de commencement.
Sollers démontre que la fin du monde se finit constamment, que peut-être cette
fin n’aura pas de fin. C’est pourquoi Paradis est un livre qui
ne s’arrête pas, qui ne s’arrête jamais, à
aucun épisode, à aucune version du monde, aucune croyance, aucune
interprétation, ni même à ce premier volume puisque de toute évidence il s’agit
au contraire du début de plusieurs volumes.
Paradis est le
plus formidable appareil d’argumentation qui soit des preuves de la
non-existence de l’homme (et conséquemment de l’existence de quelque chose qui
décolle cette non-existence de ses soudures terrestres, un abîme qui menace
l’enfer) : « de deux choses l’une en effet ou bien il est là en
retrait éternellement vivant revivant et nous sommes nous de simples
apparitions et des ombres ou bien toute cette histoire est une hallucination et
nous sommes quand même des apparitions et des ombres ». Comme toutes les
grandes oeuvres Paradis est la pièce
qui manquera éternellement au meccano du monde pour pouvoir en toute sécurité
se dire complet, c’est-à-dire divin, inengendré, éternel dans ses cycles
d’autogenèse.
Comment laisser entendre qu’il y a quelque chose qui échappe à la chute comme à
la prétention de s’autogénérer pour
s’autogérer ? Par un langage qui la précède, un langage jamais entendu,
venu d’ « ailleurs ». Voyez ce passage merveilleux (p.229) qui
raconte ni plus ni moins une illumination dans un matin de
mai : « on croisait dans l’adriatique grise et bleue gravée noir
sur bleu (...) quand soudain en tout cas soudé au soudain il se mit à muter
sous moi le longage à m’évacuer à souffler de tous
les côtés (...) et cela faisait signe à moi qu’un certain rire m’était réservé
à moi une certaine façon de percer l’horizon ». L’illumination rebondit à
Venise, aux Gesuati balayés par un prélude de
Bach : « alors quoi ils avaient tenu comme ça deux mille ans et
moi j’avais oublié ça à vingt cinq ans ». Il faut précéder l’enfer pour le
voir. Paradis est cet effort de précession. Sa langue est une
résurrection vers l’antérieur, une remontée de l’amnésie. Sans cesse Sollers
insiste sur la voix. C’est une voix qui crée le monde, la voix du « Je
suis celui qui suis », « Je serai ce que je serai »,
la voix qui en créant a creusé un infranchissable fossé entre elle et
l’incomplétude humaine. C’est en lisant à voix haute qu’aux tout premiers
siècles de notre ère on pénétrait le sens de textes dépourvus eux aussi de
ponctuation et même d’intervalles entre les mots. Faire voir ce monde tel qu’il
est dans sa chute, c’est qu’il n’est que la suite, la queue coupée d’une
voix : « au principe de tout et surtout de l’humanitout était la parole et la parole était chez je suis et la parole était au principe
au je suis ». Il y a dans Paradis un effort constant pour
refaire passer dans notre oreille ce principe perdu. Que cette recherche soit
écrite donne immédiatement au fait d’écrire un sens nouveau, pour ainsi dire en
relief : tout se passe « au fond de la page car la page n’est
pas une surface comme ils le croient ». Tirs fusants, rasants, bordées,
semonces : les rafales de syllabes reviennent vers le lecteur avec
d’autant plus de puissance qu’elles montent de ce fond de page qui fait de
toute surface un filigrane du néant.
Quant au système de répétition qui rythme le
livre, il était nécessaire pour démontrer qu’à l’inverse de la croyance commune ce monde n’est pas infini puisque ses possibles
n’arrêtent pas de se répéter indéfiniment. Il fallait écrire cette répétition,
énigme de la pulsion de mort du vivant, afin de prouver « ailleurs »
l’existence en sourdine d’une éternité. Plus il y a de la répétition chez
Sollers, plus on voit à quel point le répété courant est du semblable, du
pléonasme, et le répété de Paradis du différent absolu.
J’en arrive à la découverte suprême de ce
livre : le scrupuleux réalisme des détails suppose un lieu d’observation
où les contours de ces détails ont disparu, une lumière telle que celui qui y
parle n’y est plus rien d’autre que capacité lumineuse, lumière sur lumière
loin de l’inanité de la nécessité corporelle, des tentatives de pensée par
catégories, péroraisons, discours, thèmes et symboles. Si les objets de ce roman sont si précis, c’est à cause de ce "point
de vue" où est parvenu à se trouver - par quel effort ? - celui qui a
écrit. C’est ce qui s’appelle se mettre à la place de Dieu ? Occuper la
non-place, le sans-lieu de Dieu qui déloge les pénates du diable en place, ses
reposoirs funèbres et ses déesses-lares... Car le diable existe, lui, incarné
dans notre incrédulité, « et non seulement il existe mais il n’y a
que lui qui résiste ». Paradis est un long voyage hors
des positivités infernales de ce monde. Descendre au fond de la page, traverser
l’être du fond, déchiffrer le paraître dans un peut-être écrit : devenir le non être, c’est-à-dire la Voix.
Etre « au paradis c’est-à-dire en plein aujourd’hui ». Lira-t-on
un jour ce livre comme la fin - accomplissement et conclusion - des
théologies ? Nous n’en sommes pas là naturellement. Il y a d’ailleurs aux
dernières pages un épisode où la question est traitée sous un angle
humoristique : le livre, le volume physique du livre, devient à la sauvette
pierre angulaire du Temple, d’une certaine façon concrète et parodique, en
cachette. Le microprocesseur lui-même est glissé dans le mur antique de la
cathédrale et c’est autour de lui que tout sens se réinvente. L’ordinateur dans
l’église : nouvelle et incommensurable image dans le tapis.
Paradis est
donc tout cela. De nouveau parmi nous il y a quelque chose comme une Comédie
Humaine ou des Mille et une nuits. Un jour, comme il
existe un "index des personnages" de Balzac ou de Proust, un "annotaded index" des Cantos de
Pound, il y aura un index thématique de Paradis. Sollers ne fait
que commencer. Approchez vous : sur une table de dissection écrite,
viennent de se rencontrer les labyrinthes électroniques des microprocesseurs et
les dédales paradisiaques gravés dans les dallages médiévaux. C’est tout près.
C’est au bout des maladies humaines, c’est leur annulation. Il suffit de se
mettre à lire pour sentir à la fois comment nous sommes là et comment nous nous
éclipserons.
Philippe Muray
Art press 44, janvier 1981
|